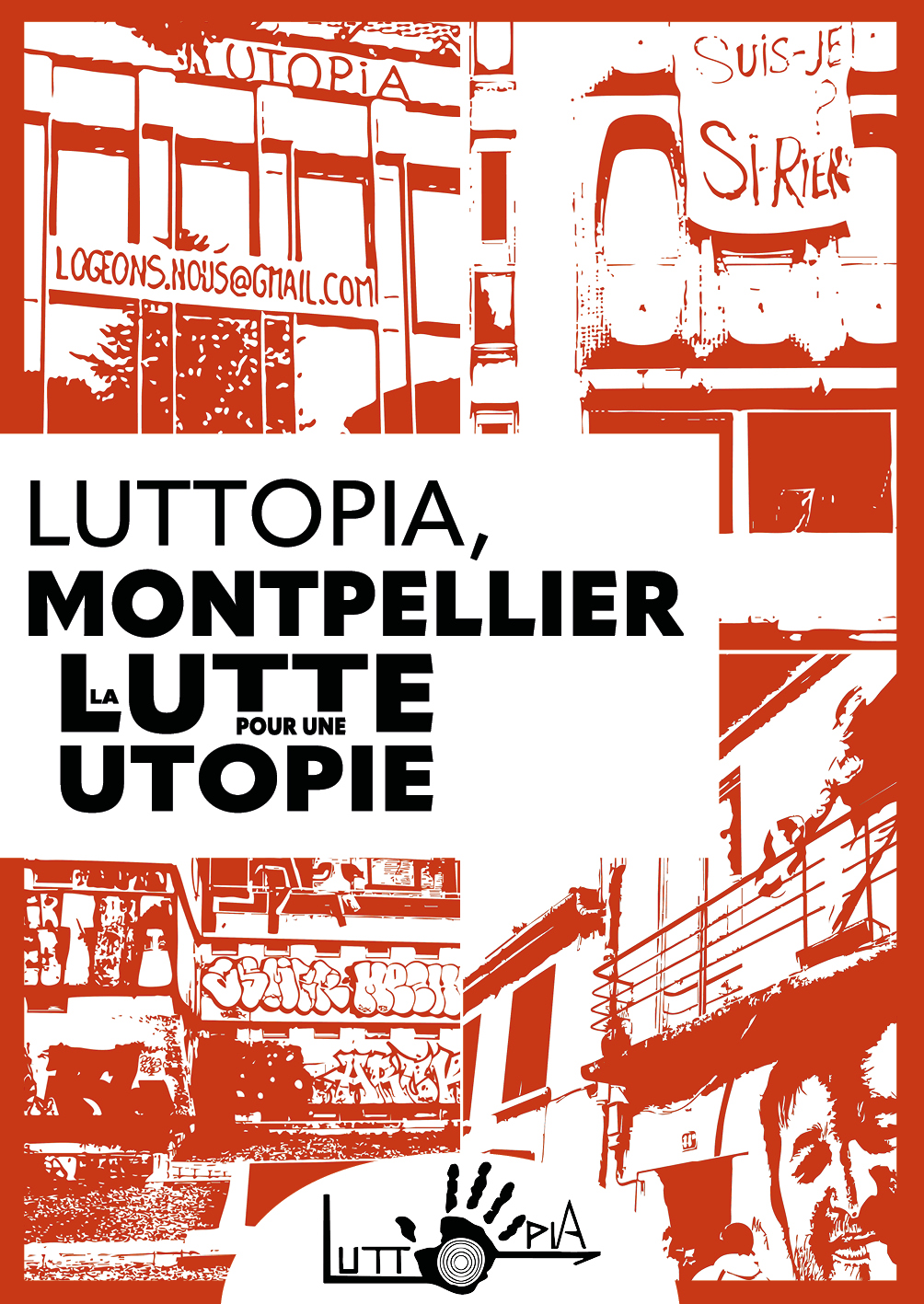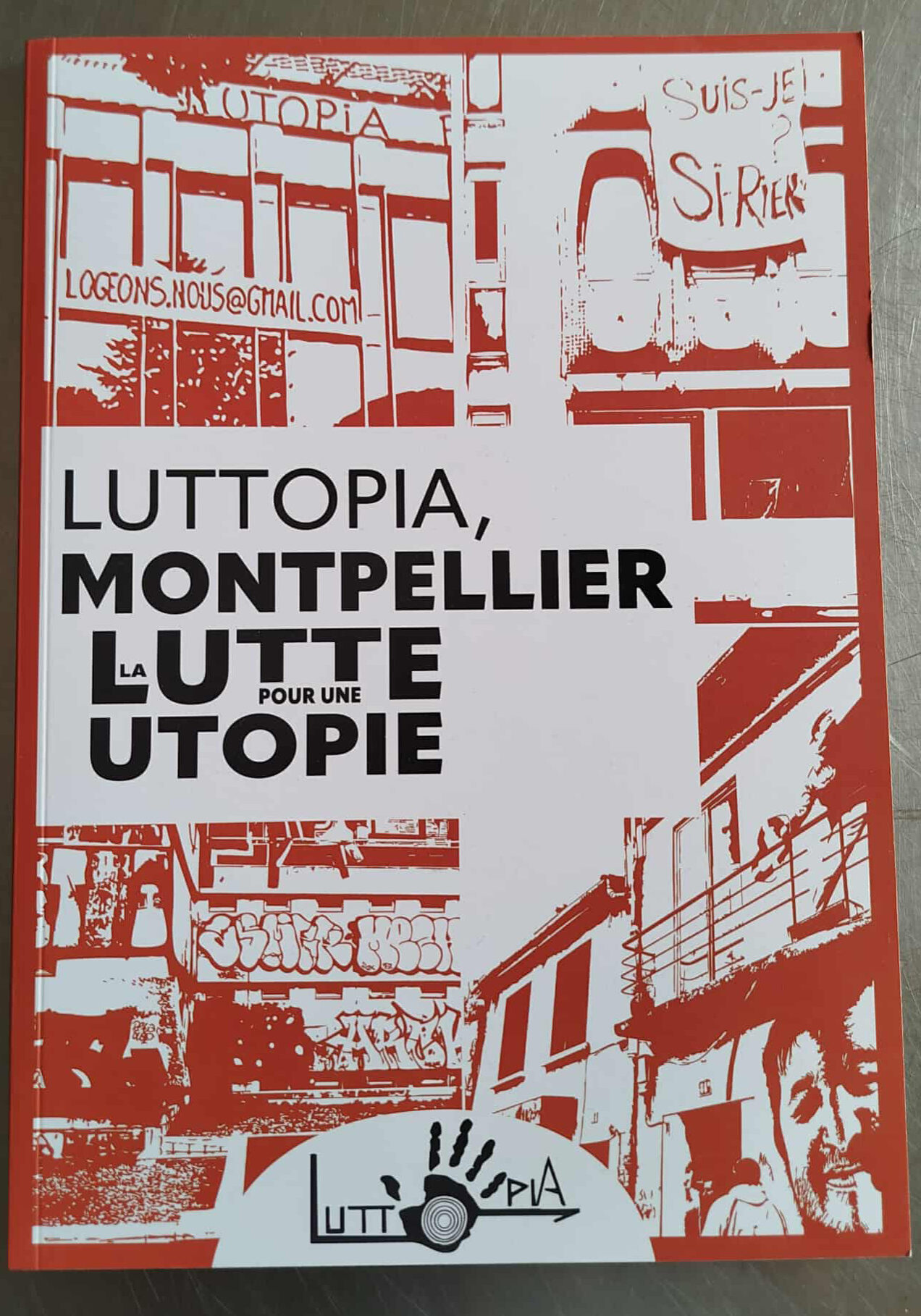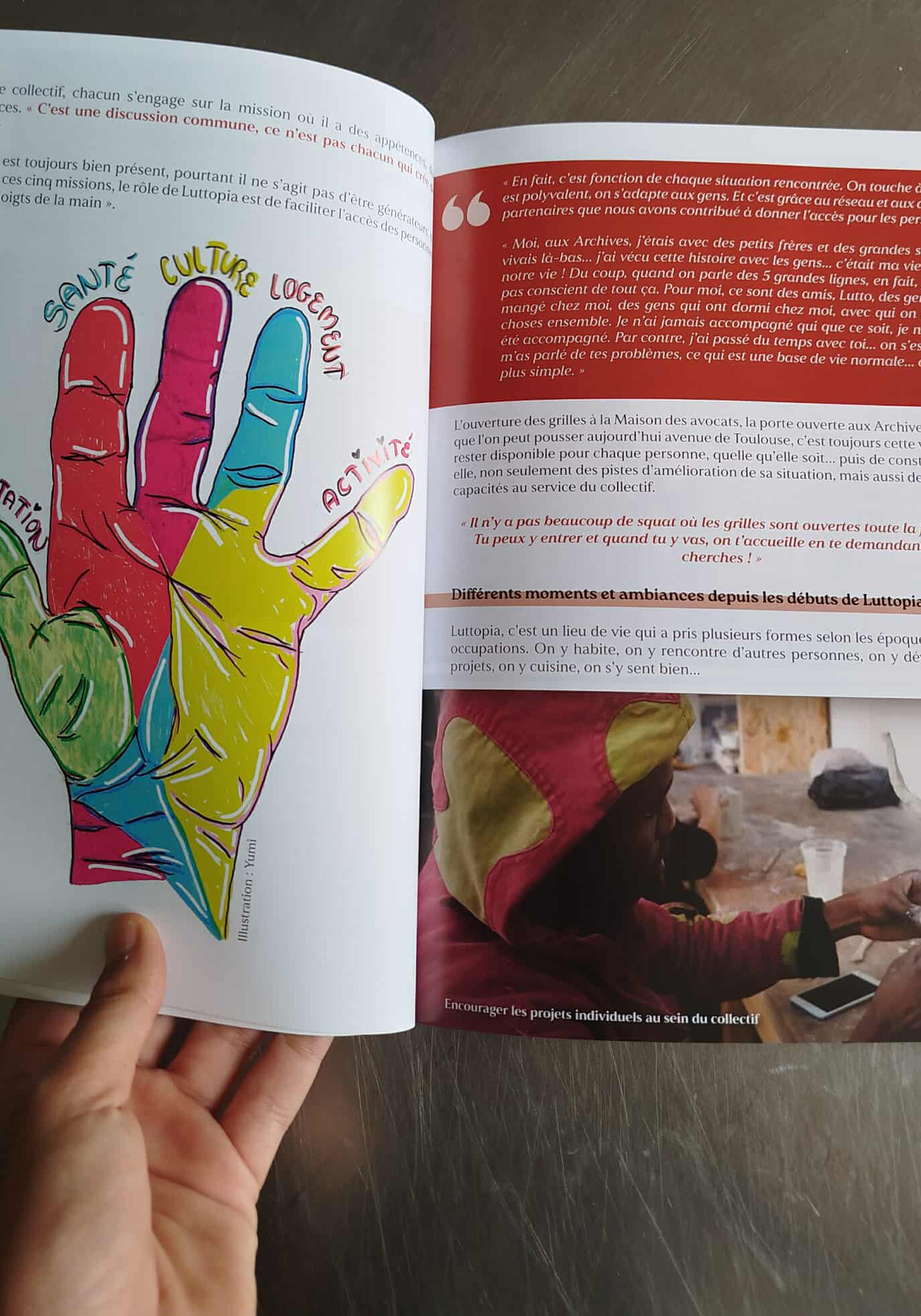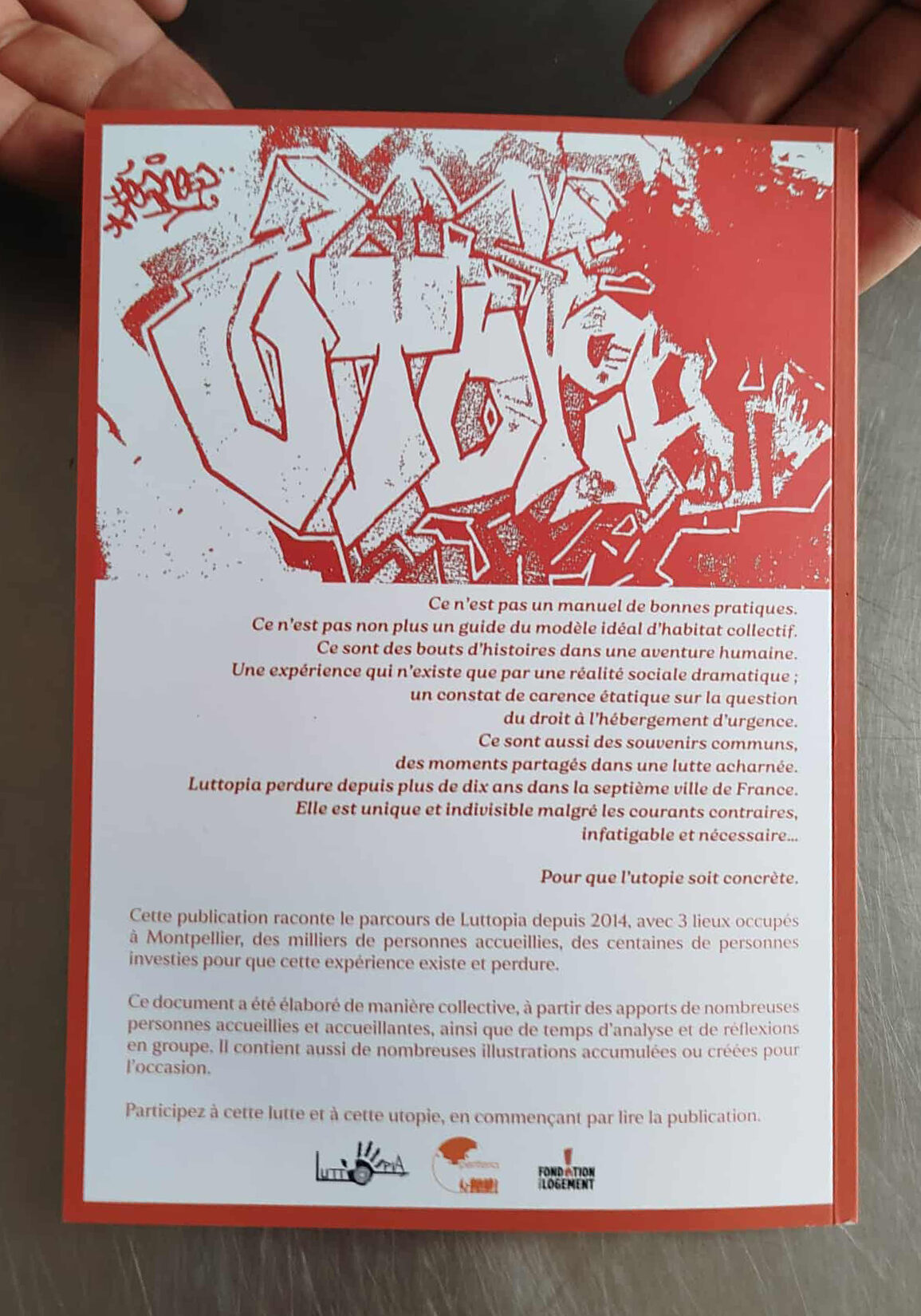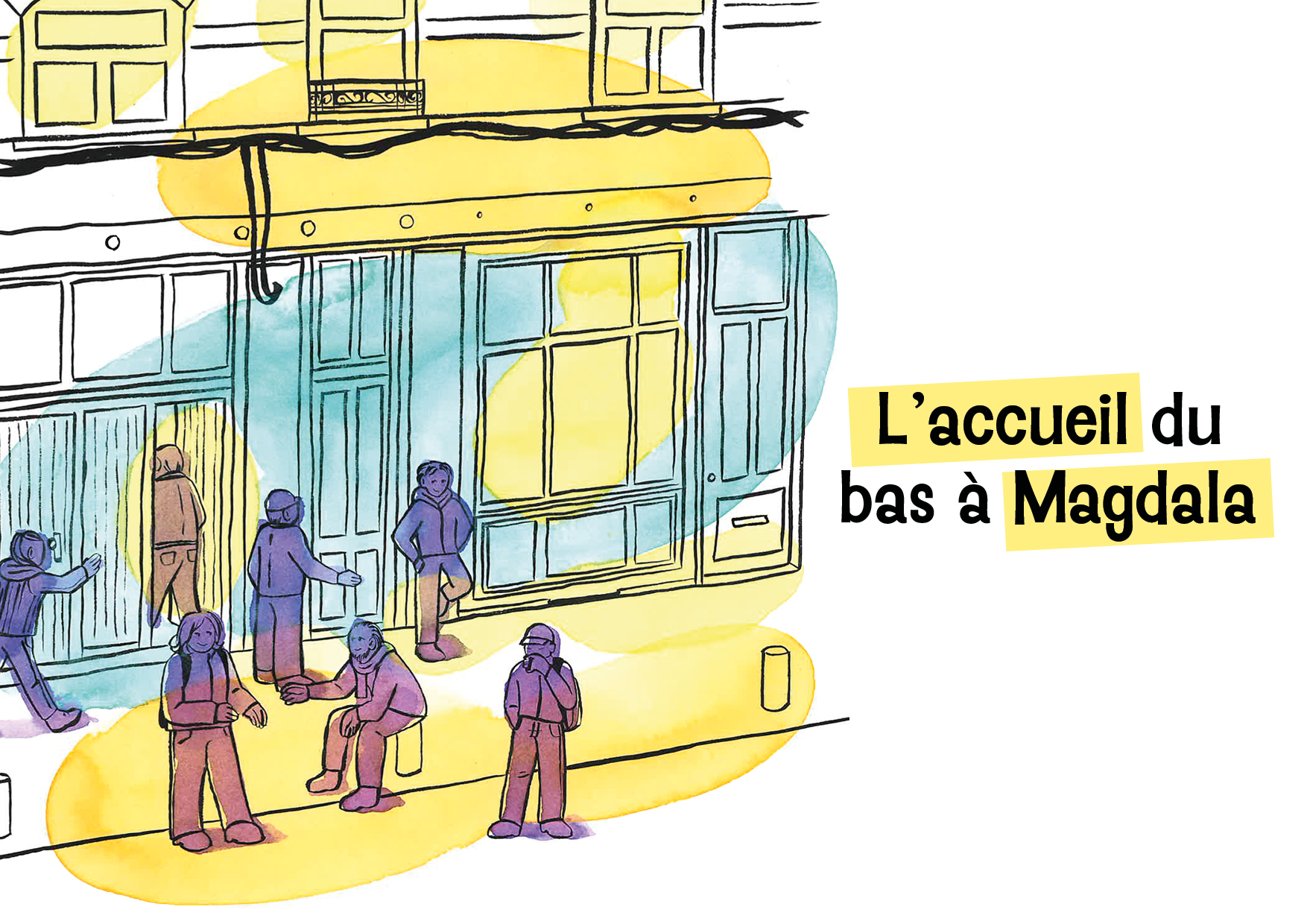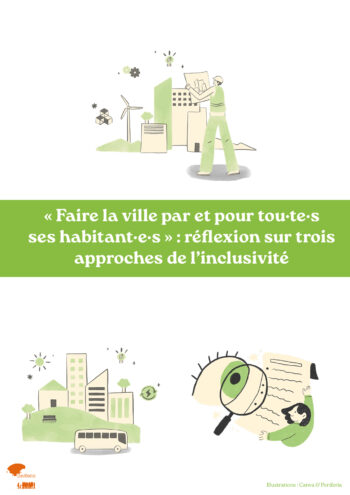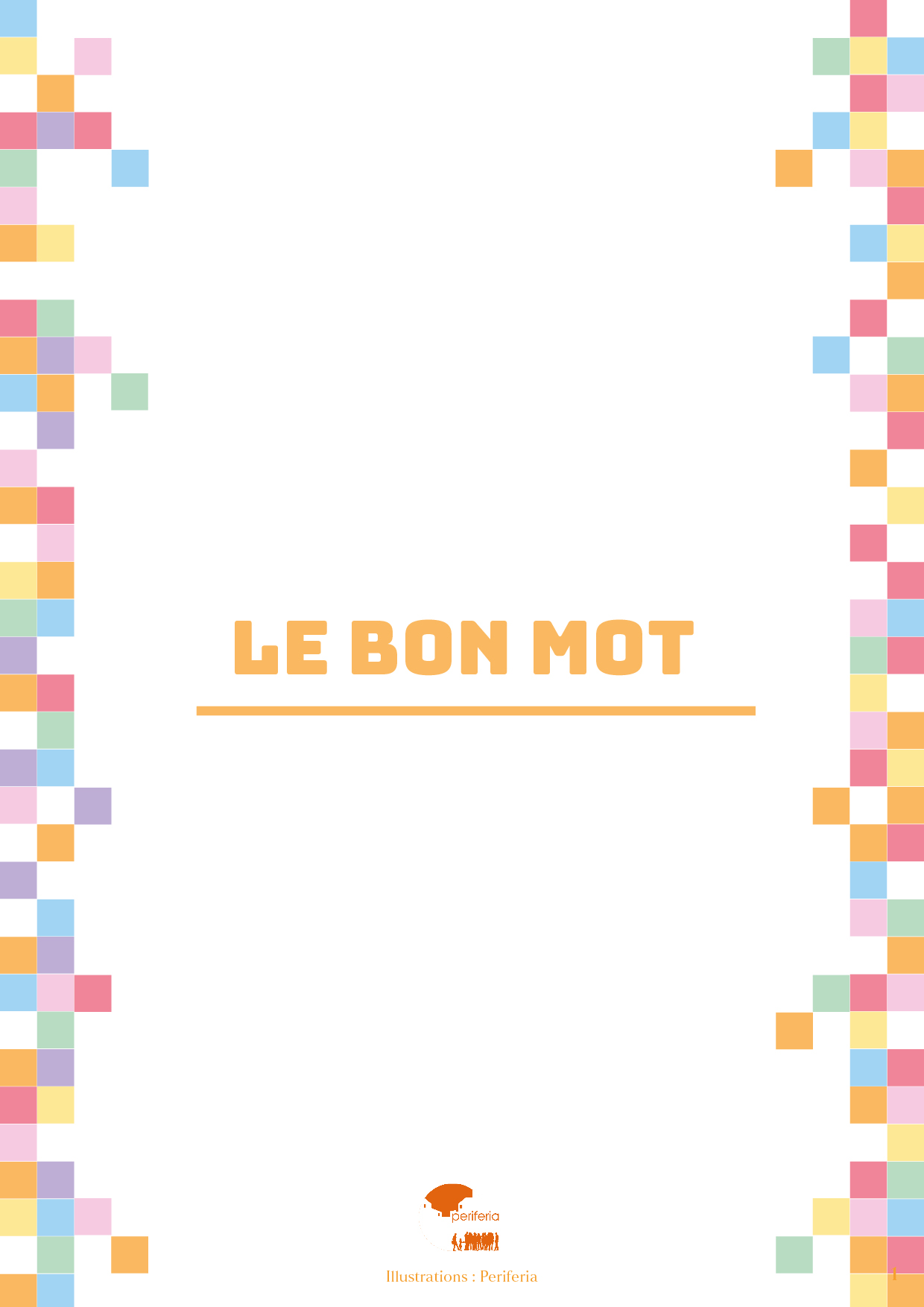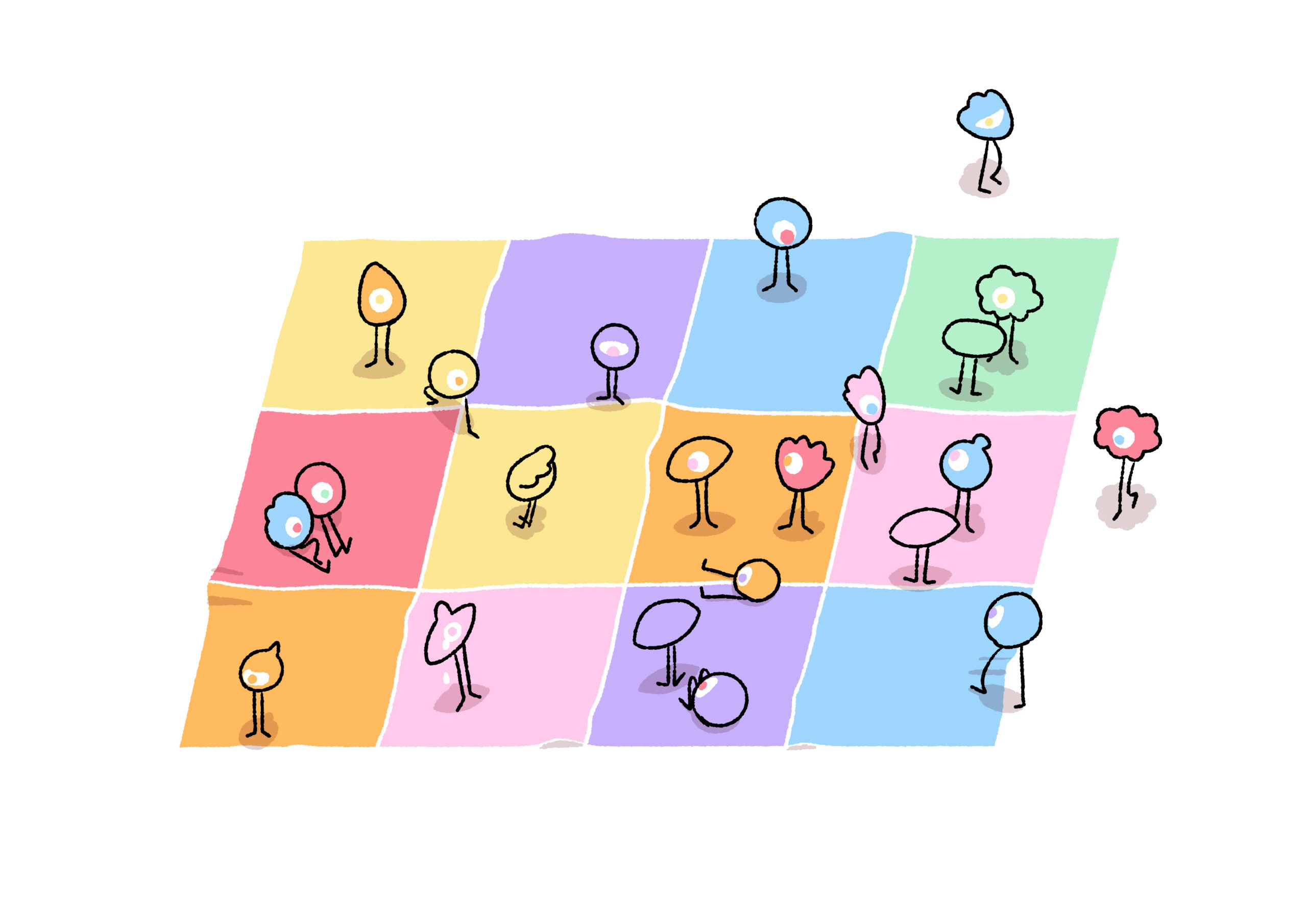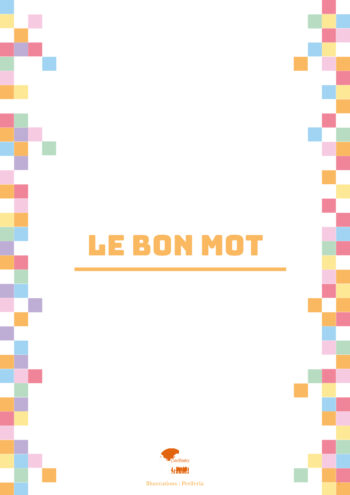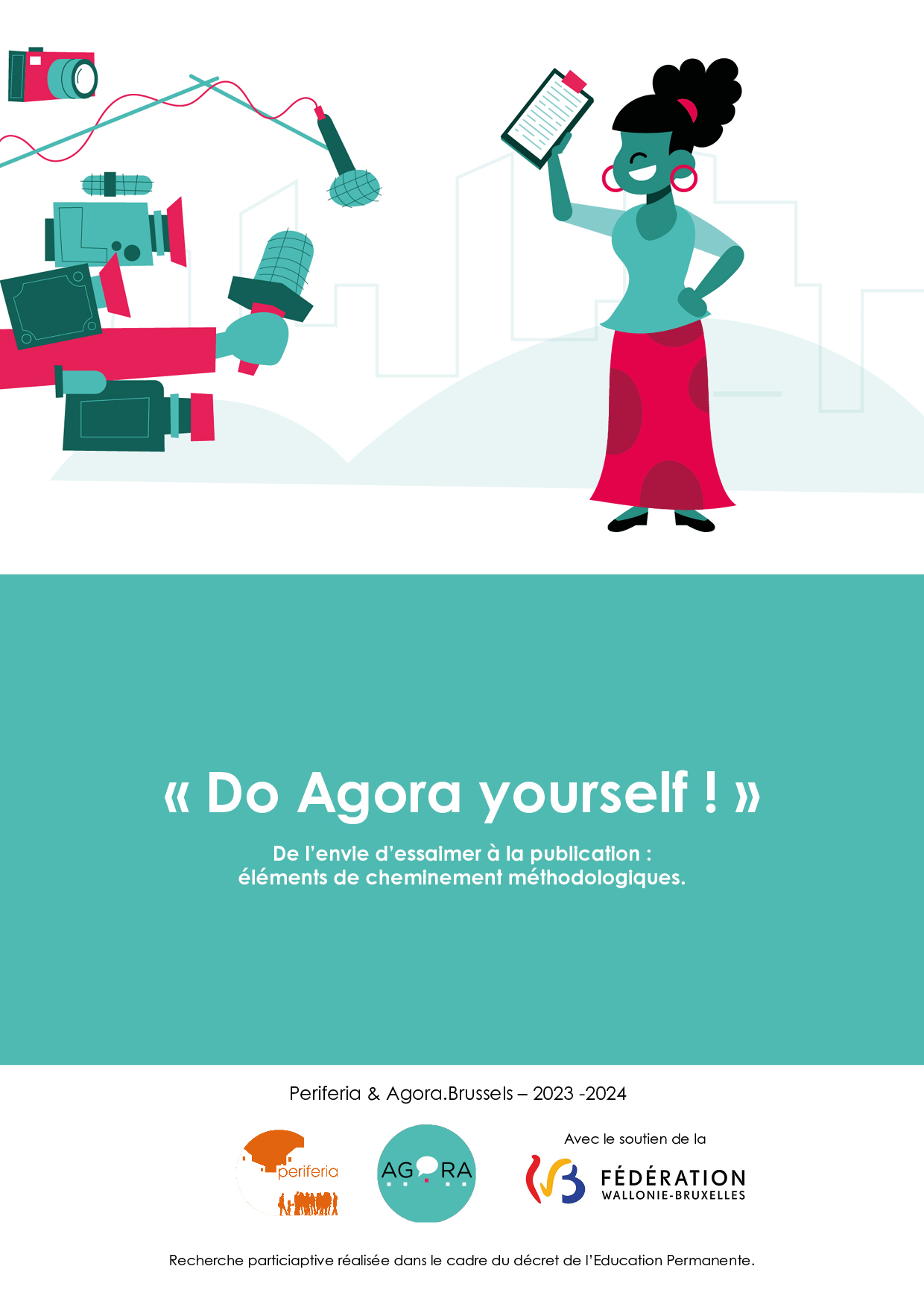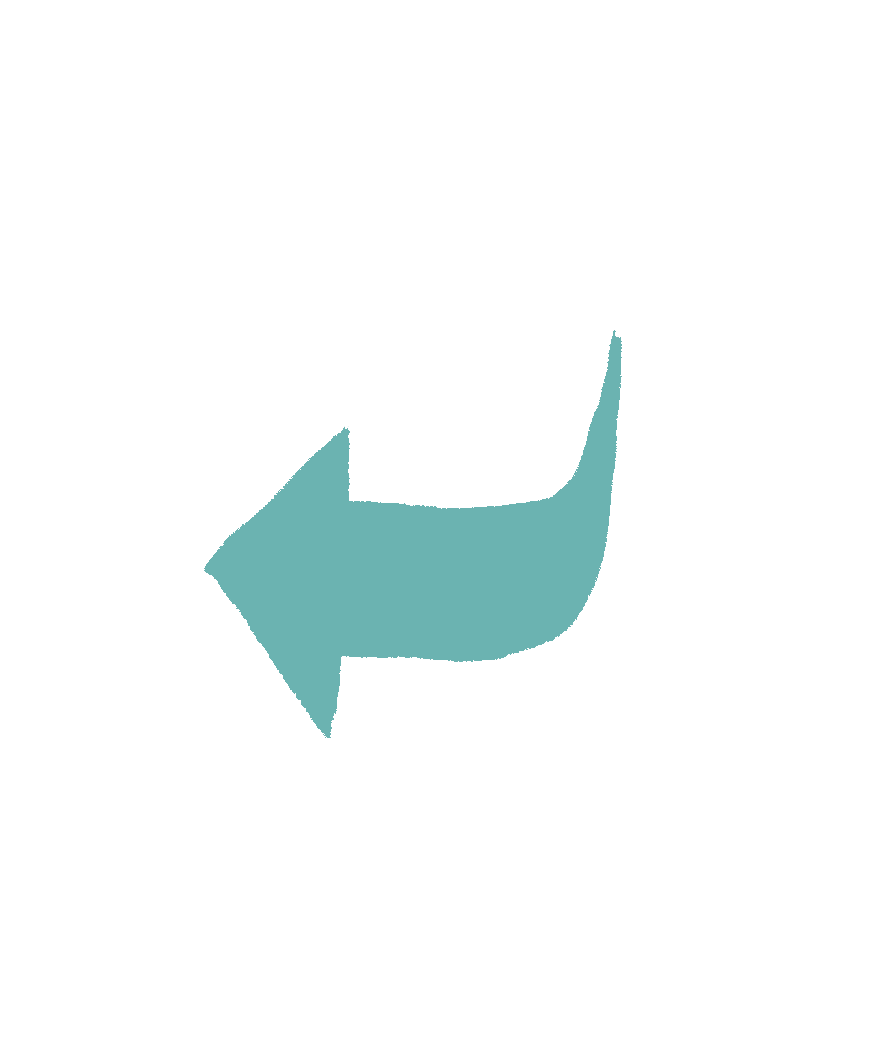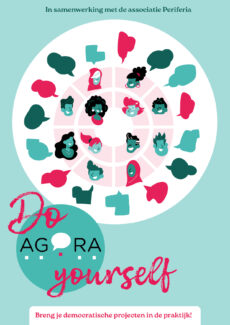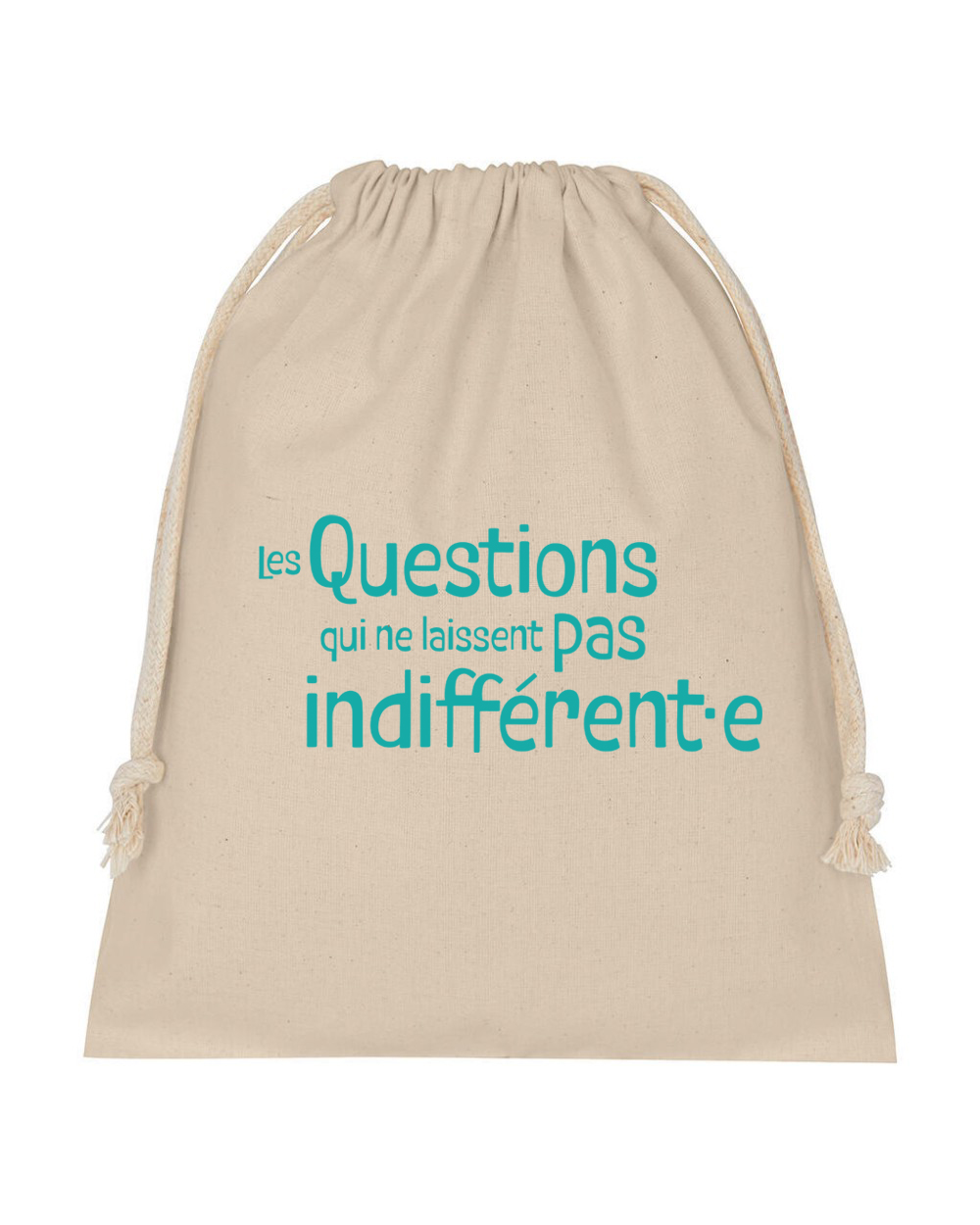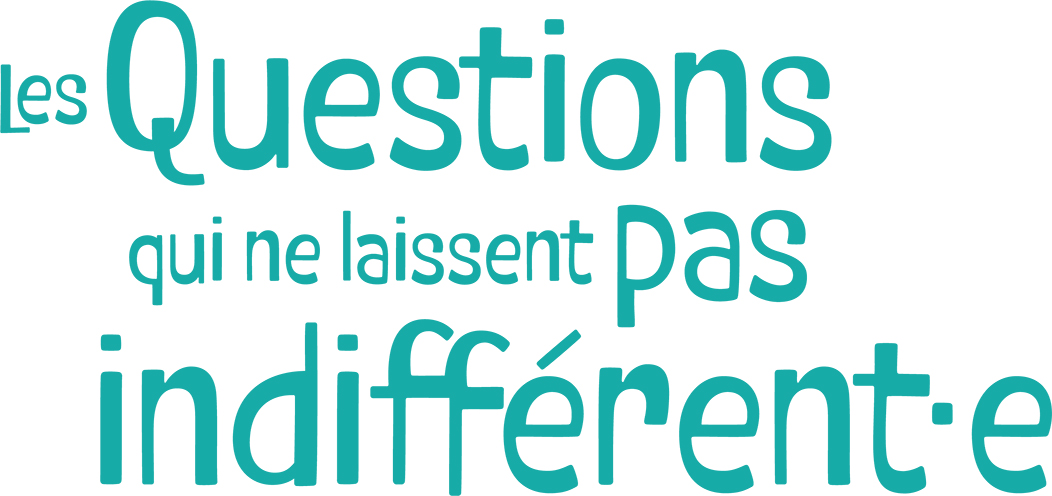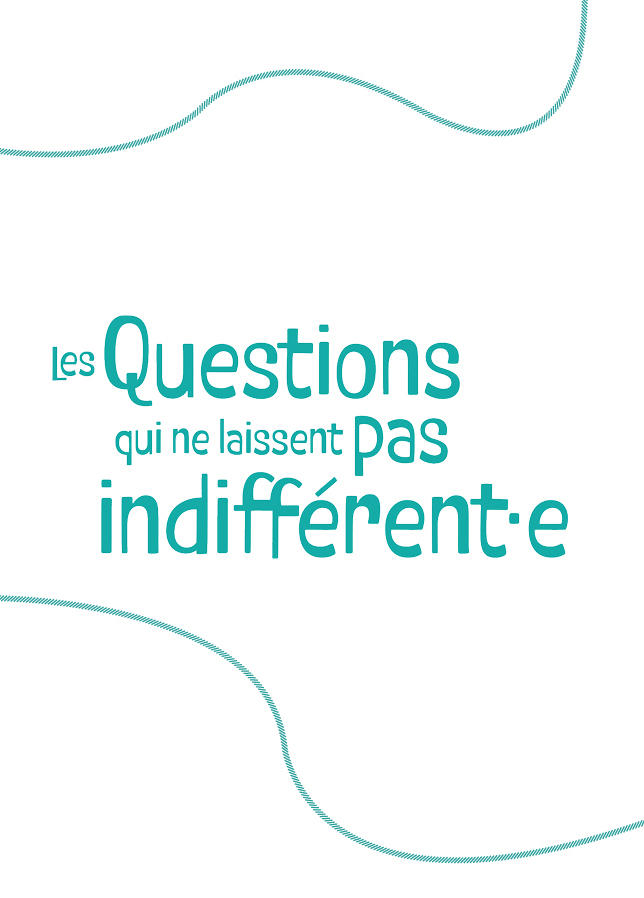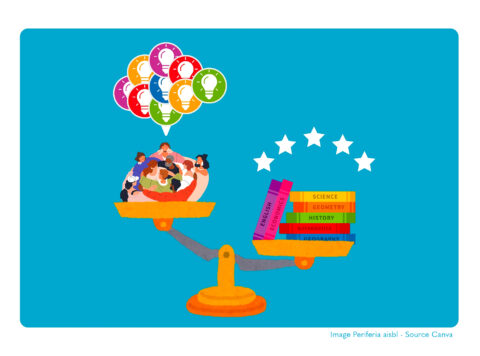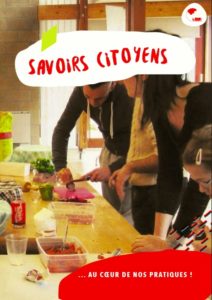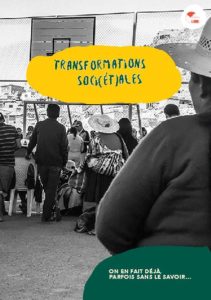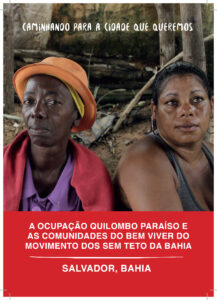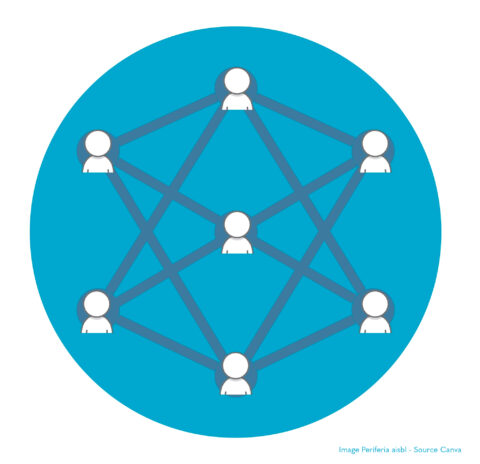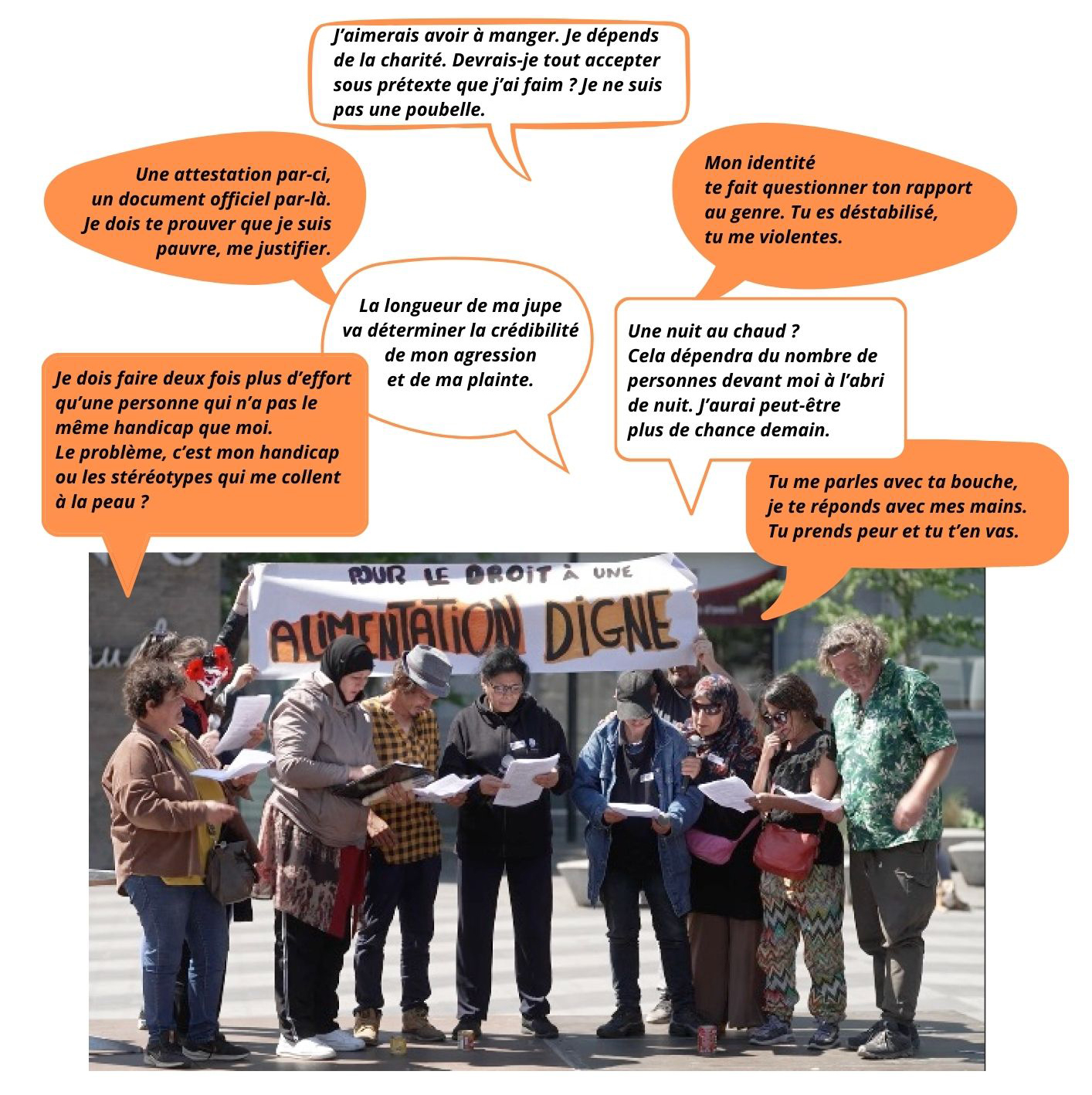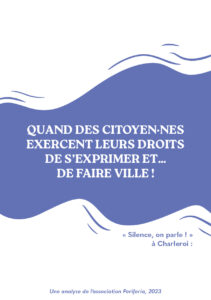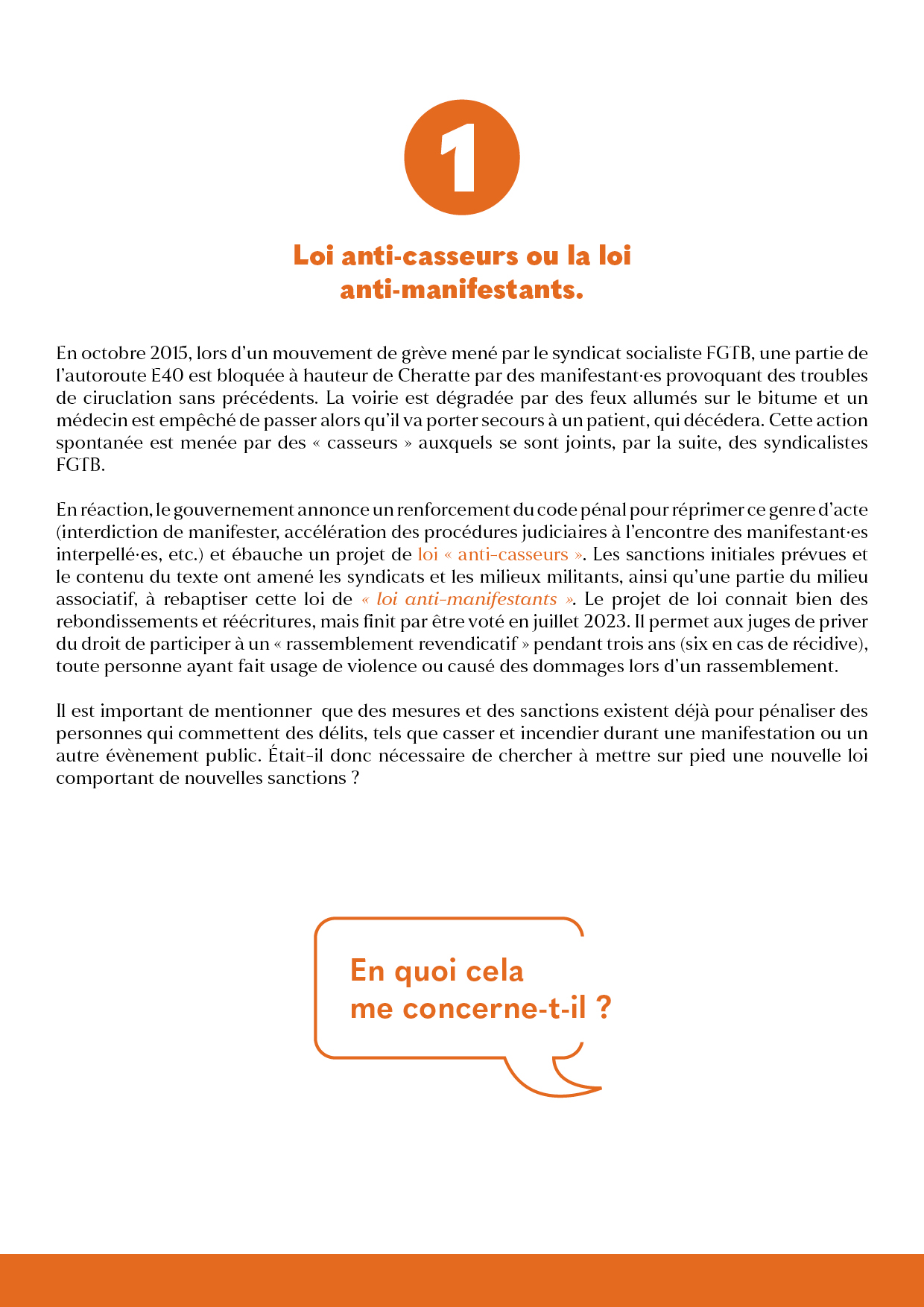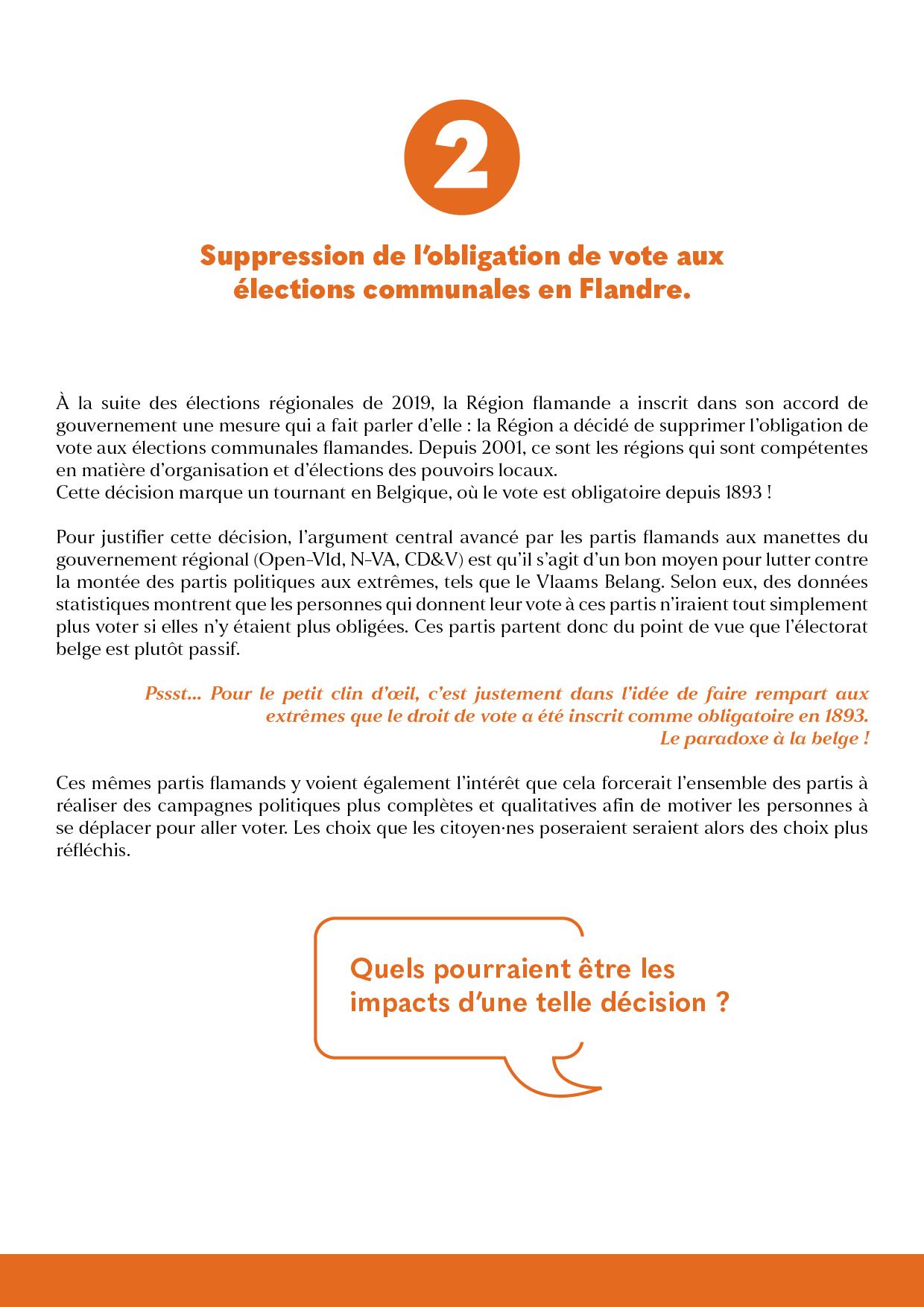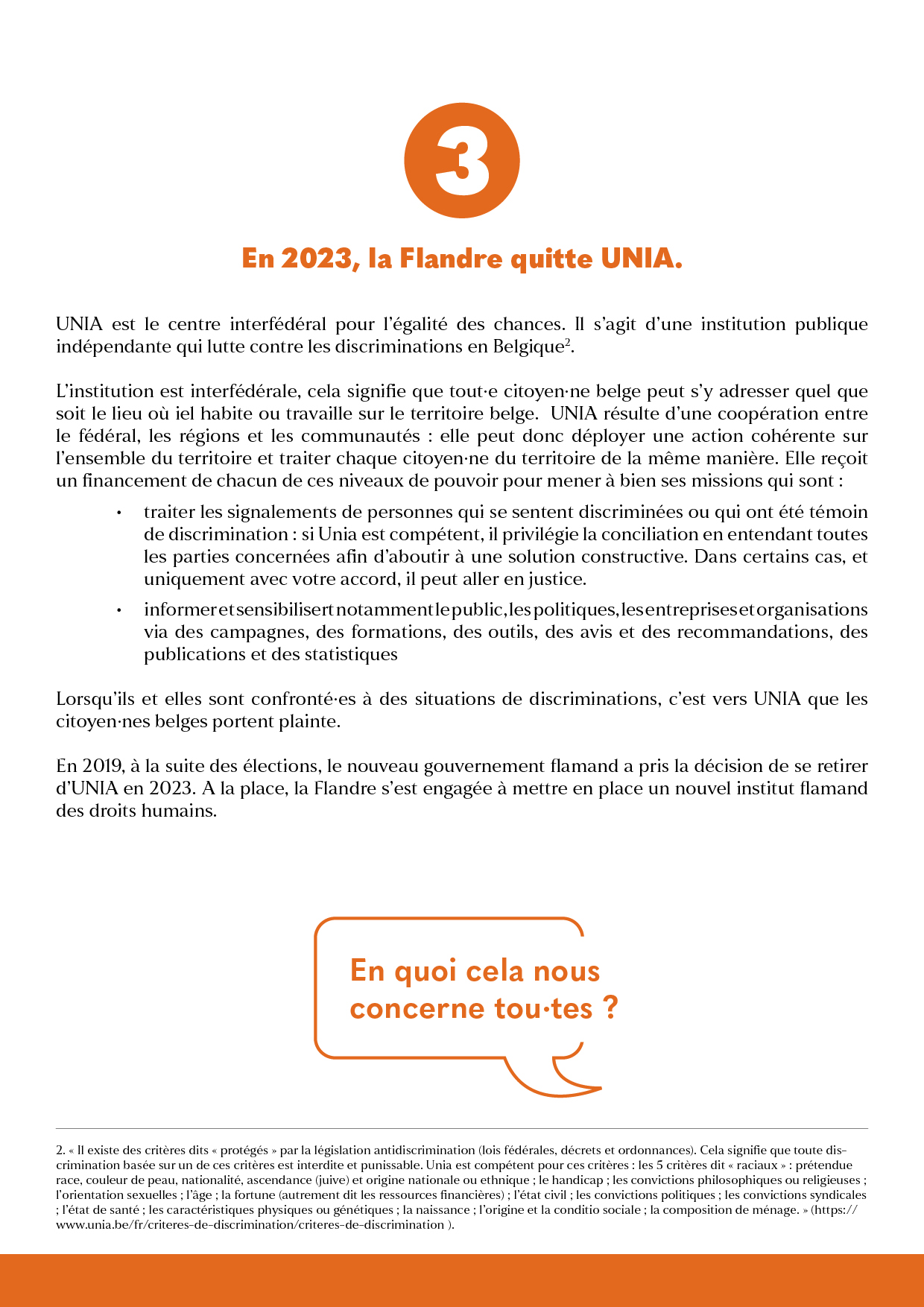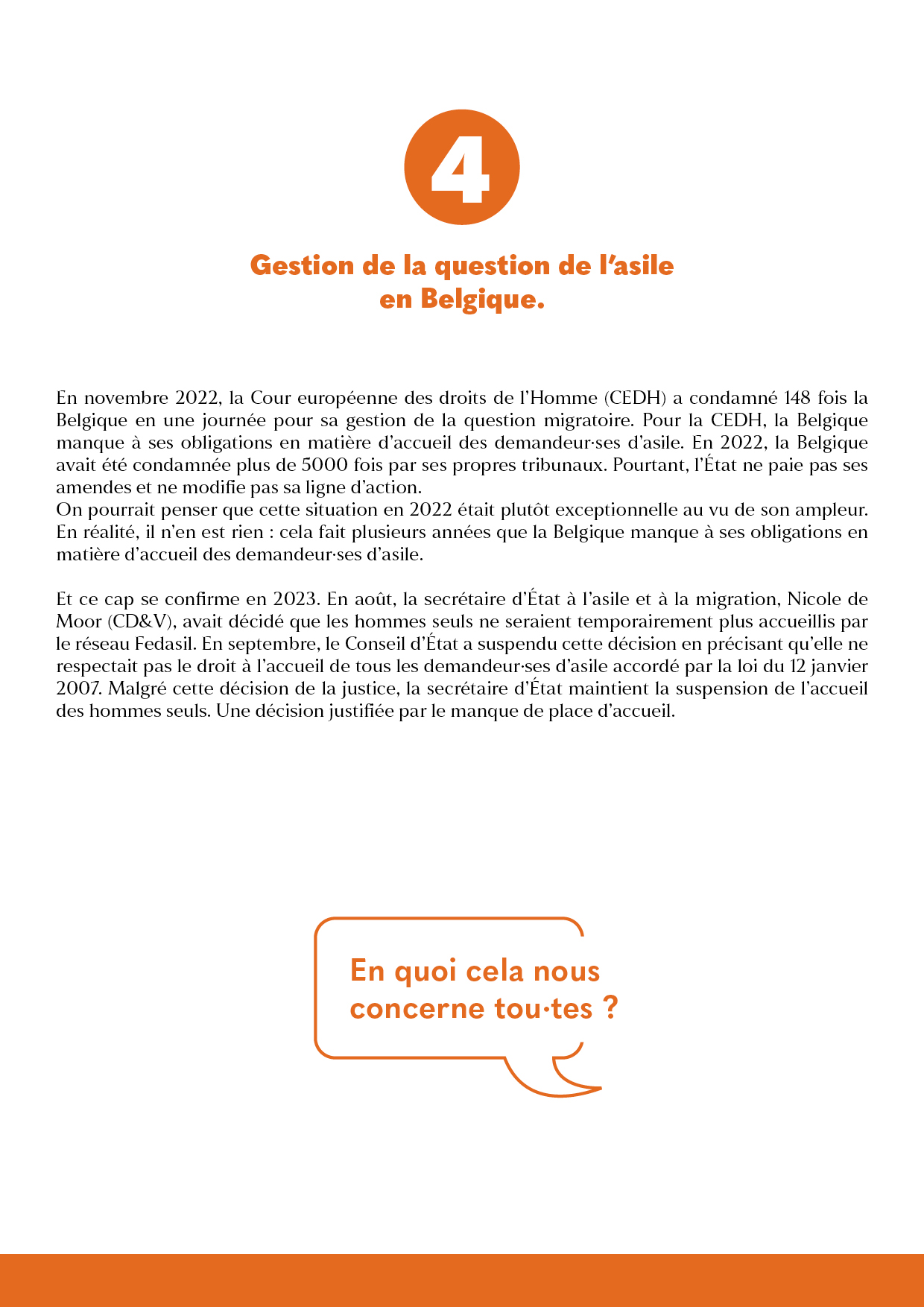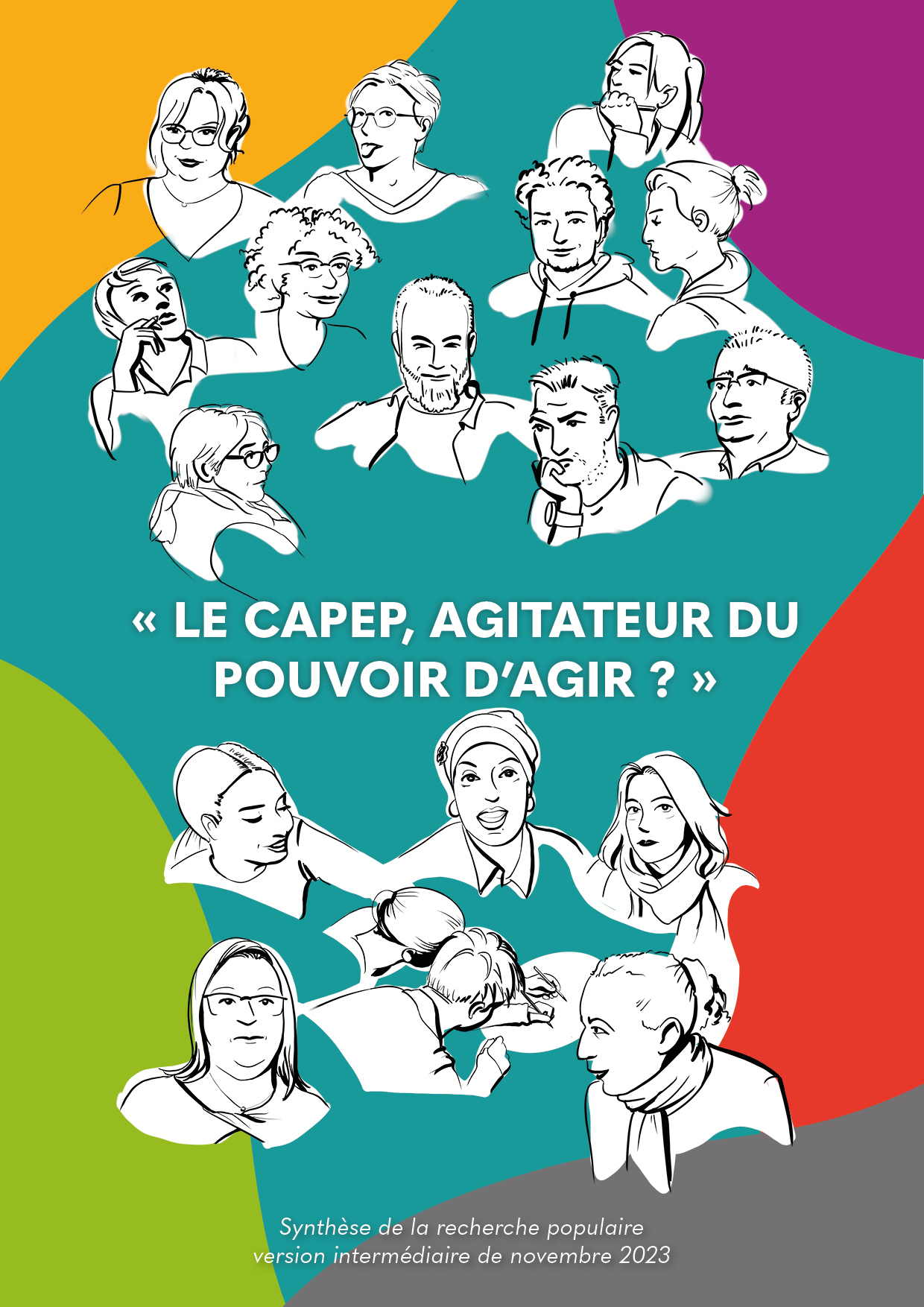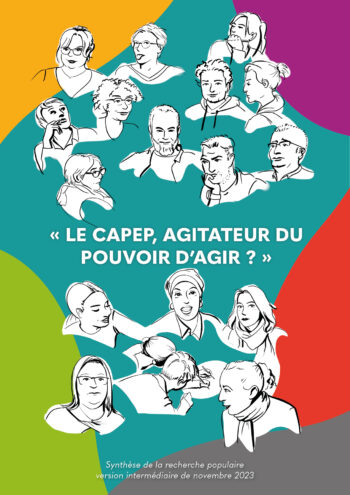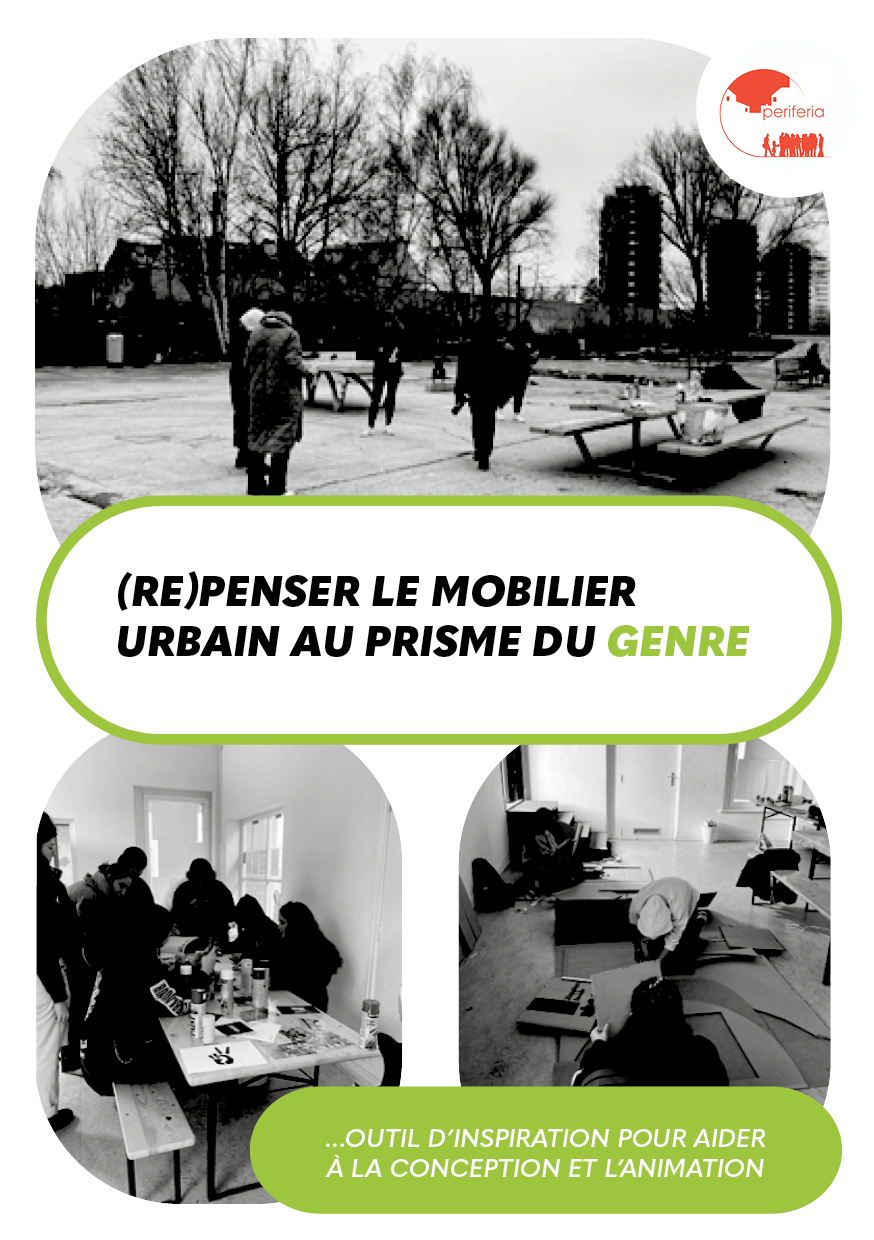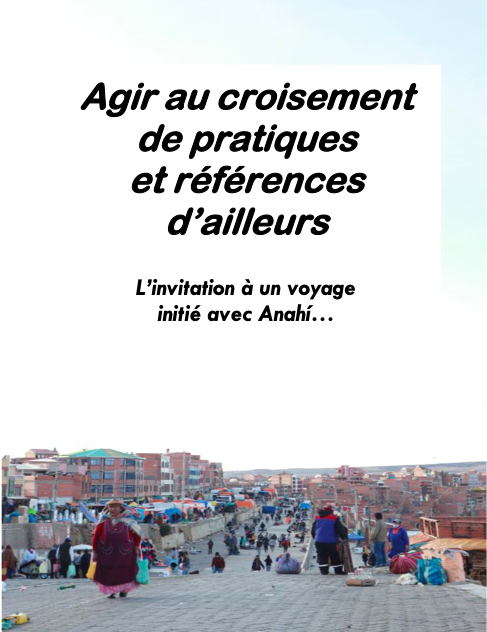Célébrer
Depuis que les pratiques d’intelligence collective se diffusent, l’appel à « célébrer » se fait omniprésent. « Il faut célébrer », « la dernière étape, c’est bien sûr la célébration ! ». Cela sonne comme une évidence… pourtant, force est de constater que si nous connaissons parfaitement les codes et attentes de célébrer nos anniversaires, les fêtes de fin d’année, une union ou une naissance, pour ce qui est de célébrer un processus collectif, on se retrouve souvent démuni·e·s.
Au départ de cette exploration, nous avions pour intention de partir à la rencontre de pratiques de célébration, originales, créatives et surtout ancrées dans les diverses luttes menées par des collectifs et organisations comparses. Notre premier élan était de nourrir d’autres acteurs et actrices de terrain en les éveillant à la multitude des formes de célébrations possibles (une intention toujours présente !). Mais, très vite, au fil de nos échanges avec les collectifs qui nous ont guidé·e·s dans ce cheminement, nous nous sommes rendu compte que, bien plus qu’une question méthodologique, la démarche de célébrer était jalonnée de nombreux questionnements, limites, voire tensions.
Elle mérite donc d’abord une exploration de ces questions de SENS et portée politique.
Au travers des expériences, questionnements de collectifs ainsi qu’avec l’appui des analyses de plusieurs auteur·rice·s militantes, nous avons décortiqué ces enjeux, tenter de déconstruire certaines idées limitantes pour finalement les dépasser




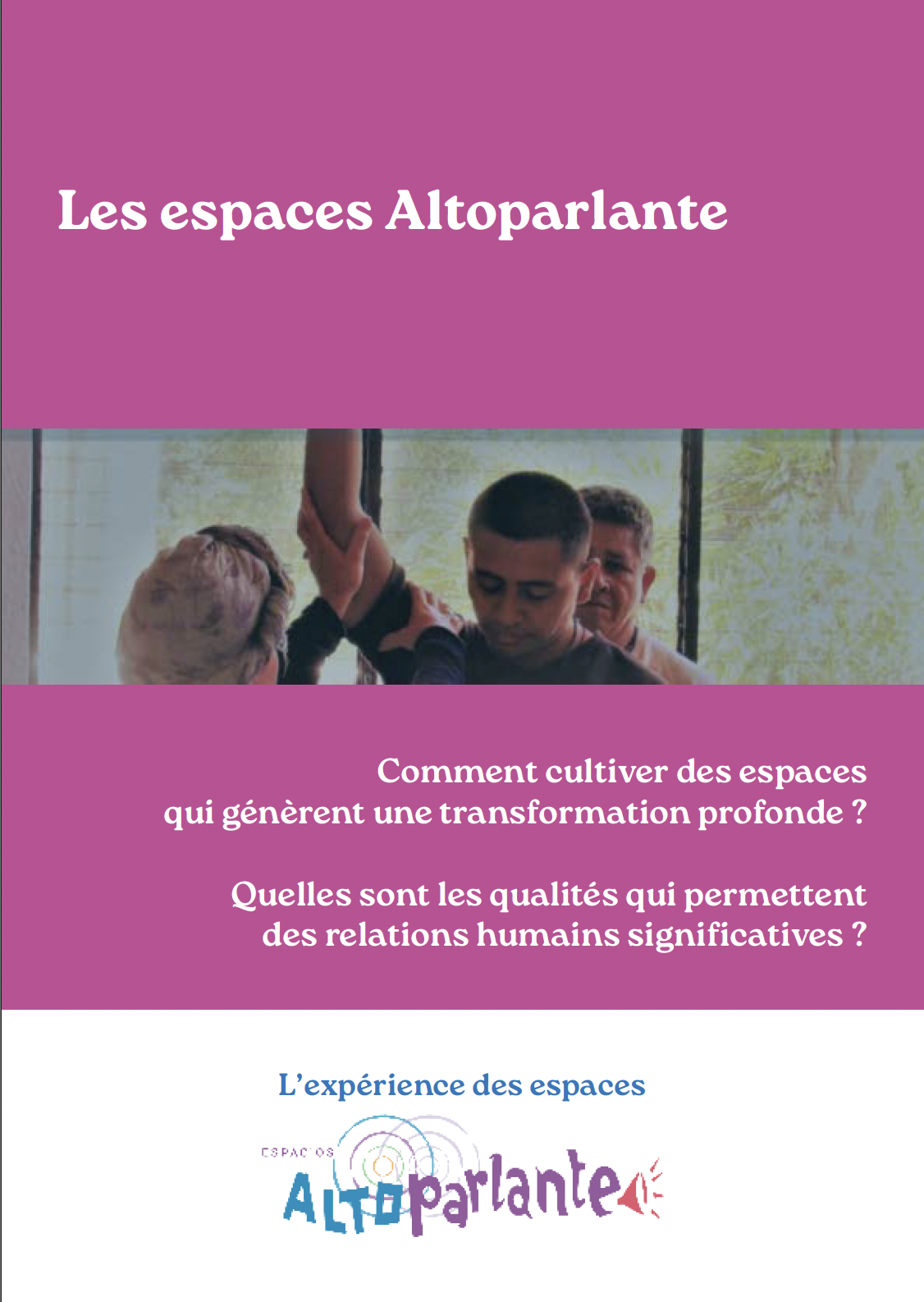


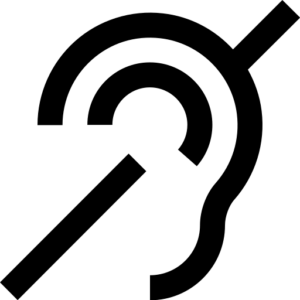 Retrouvez la transcription ci-dessous.
Retrouvez la transcription ci-dessous.