« Silence, on parle ! » 2024 : Écoutez les quelques réactions et retours sur cette journée
Nous avons recueilli six réactions sur la journée du Silence, on parle ! de Namur. Vous pouvez les écouter une à une en cliquant sur le bouton play.
La transcription de chaque témoignage est inscrite à droite du média ![]()




Et vous comment avez-vous vécu cette journée du "Silence, on parle !" ?
Extrait 1 :
« J’ai trouvé ça émouvant. Ça m’a replongée dans les émotions que j’avais ce jour-là, parce que le public a été amené à s’exprimer. Ce sont des gens que l’on n’entend pas souvent et c’était justement le but. Et j’ai trouvé ça particulièrement émouvant que les gens viennent dire ce qu’ils ont dans les tripes sur la place publique. Je n’avais jamais vu ça en fait. Je n’avais jamais assisté à ça. Donc, j’avais limite les larmes aux yeux. Bon, je suis quelqu’un d’émotive. C’est facile de m’arracher des larmes. Mais là, ça m’a vraiment replongée dans les émotions que j’ai ressenties à ce moment-là. Je trouve que ça ouvre les yeux aussi, parce que l’on se dit que souvent, on est tous dans notre petite vie, avec nos petits problèmes, … et on prend rarement conscience des autres problèmes que d’autres personnes peuvent rencontrer. Et quand on se retrouve face à des gens qui sont porteurs de handicaps, qui ont vécu dans la rue, ou qui y vivent toujours, ça remet les choses en perspective. Et ça botte un peu le cul. »
Extrait 2 :
« On a terminé notre discussion avec une des phrases des Arsouilles. Je crois que ce que tu retraçais Nicole : ‘’C’est pas qu’on nous entend pas, c’est qu’on nous écoute pas ! ‘’ Quelque chose comme ça. Et que le Silence, on parle ! ça remettait ce truc-là dans le fait que c’est pas qu’on est sans voix, c’est juste qu’on nous écoute pas. Et j’aimais bien ton image : le Silence, on parle ! c’est ça aussi, c’est aussi dire qu’on a plein de manières de faire et de propositions que l’on rend visibles sur scène. Et ça a une portée politique un peu forte de dire ‘’Non seulement vous écouter pas nos colères mais en plus, vous ne voyez même pas les choses que l’on invente. ‘’ J’ai retenu ça et j’ai trouvé ça chouette. On a aussi parlé de ce côté diversité, de mélange, … Et on s’est rendu compte qu’on se souvenait même plus du thème global du Silence, on parle ! Si c’était les discriminations, mais en fait c’était pas important parce qu’il y a eu des saynètes, des paroles et des gens hyper divers qui se rejoignaient quand même autour d’un fil. Et puis, même si on se souvenait pas du bon mot, ça continuait de parler de justice, de dignité, … »
Extrait 3 :
« Et du coup, bah moi, je rejoins aussi le côté très touchant, très émouvant de revoir les images. Ça fait dresser les poils franchement de se replonger dedans. Parce que c’est vrai qu’il y a eu un été qui nous a séparé de l’événement. Et je salue aussi le courage de toutes ces personnes qui osent monter sur cette scène et qui préparent de manière appuyée cette intervention. C’est pas évident de mettre des mots sur tous ces vécus. Et qui nous permettent nous aussi d’avoir une certaine prise de conscience. Même si on se rend compte que ça existe, le fait d’avoir ces ‘’tripes’’ qui soient mises sur scène et qui soient partagées, ça fait un bien fou en fait de réaliser à quel point il y en a qui se battent comme des guerriers, au jour le jour. Franchement, quelle belle initiative de mettre ça sur la place publique. Et je trouve que ça devrait être plus souvent, que ce soit ‘’imposé’’ comme ça et que les gens puissent rejoindre l’événement, y participer et dans les témoignages qu’il y avait après chaque saynète. Les personnes qui partagent parce que ça leur fait écho, je trouve ça juste fou. Donc, oui, j’étais très heureuse d’y participer et surtout d’avoir accompagné le groupe du quartier, de voir leur fierté aussi d’avoir osé jusqu’au bout du processus parce que franchement, ça n’a pas été simple. De l’avoir fait, d’être passés en premier en plus sur la scène, c’est vraiment un sacré défi pour eux, et une sacré fierté d’avoir osé aller au bout, d’avoir réussi à mettre les mots, de ne pas avoir trop bafouillé. Quand je vois les interventions du quartier dans la vidéo, je suis d’autant plus fière de ce qu’ils ont fait franchement. Merci à Periferia d’avoir permis ça. »
Extrait 4 :
« Ce qui finalement me manque dans la vidéo, parce que ça a été très fort, c’est les autres gens. Les gens qui ne sont pas montés sur scène. Et moi, j’ai ressenti énormément d’émotions aussi de la part d’autres personnes. Comme tu viens de le dire Vincent, il y en avait sur scène. J’ai été énormément touché par des personnes qui sont venues me trouver, une ou deux à la fin. Aussi des passants qui m’ont dit ‘’ Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez provoqué chez moi. ’’ Notamment, une jeune fille qui disait ‘’Mes parents ont vécu à la rue, ou vivent à la rue et vous m’avez fait vivre quelque chose en donnant de la valeur à ça aussi.’’ Franchement, je me dis qu’on ne se rend pas compte de ce que l’on provoque avec une journée comme ça. Et ça m’a énormément touché, d’entendre des réactions finalement que je n’attendais pas du tout. »
Extrait 5 :
« Comme Cécilia disait, ce qui m’a le plus marqué c’est l’émotion que ça m’a procuré et surtout le fait que cette émotion pouvait s’exprimer publiquement. Alors, moi je l’ai pas exprimé publiquement, mais c’est clair qu’il y avait aussi beaucoup d’émotions sur la scène. Et je trouvais que c’était quelque chose d’important à partager sur lequel on est pas souvent en fait. »
Extrait 6 :
« Je pense que quand tu traverses plein de moments quand tu es en galère, tu passes ta vie à raconter ta vie mais au guichet, aux administrations où tu expliques ta situation. Ensuite, tu dois justifier tel aspect de ta vie à telle administration, ou telle autre personne, tu dois le dire à tes voisins, tes amis, … Tu passes ton temps à raconter ta vie mais tu choisis pas ni ce que tu racontes, ni comment tu le racontes, ni si tu le dis en criant ou en chuchotant, … Là, tu as le droit de te mettre en colère sur un Silence, on parle ! C’est toi qui choisis ce que tu dis. »


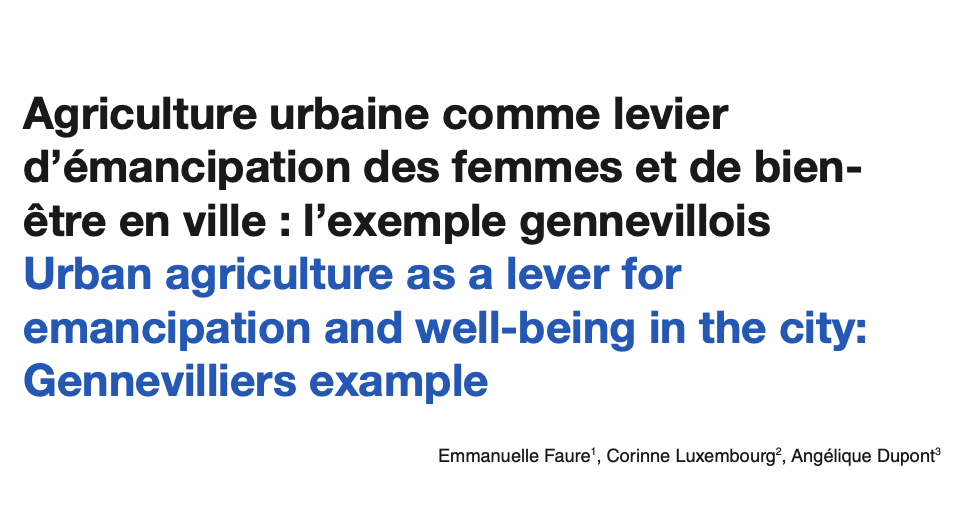

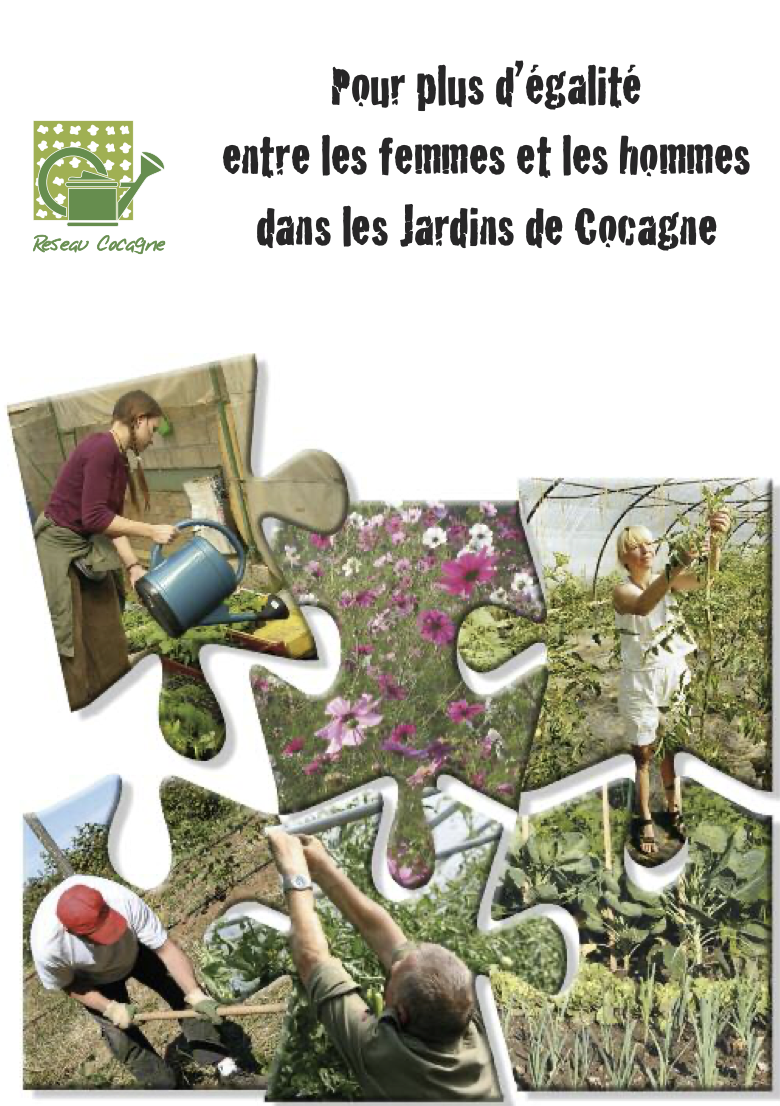
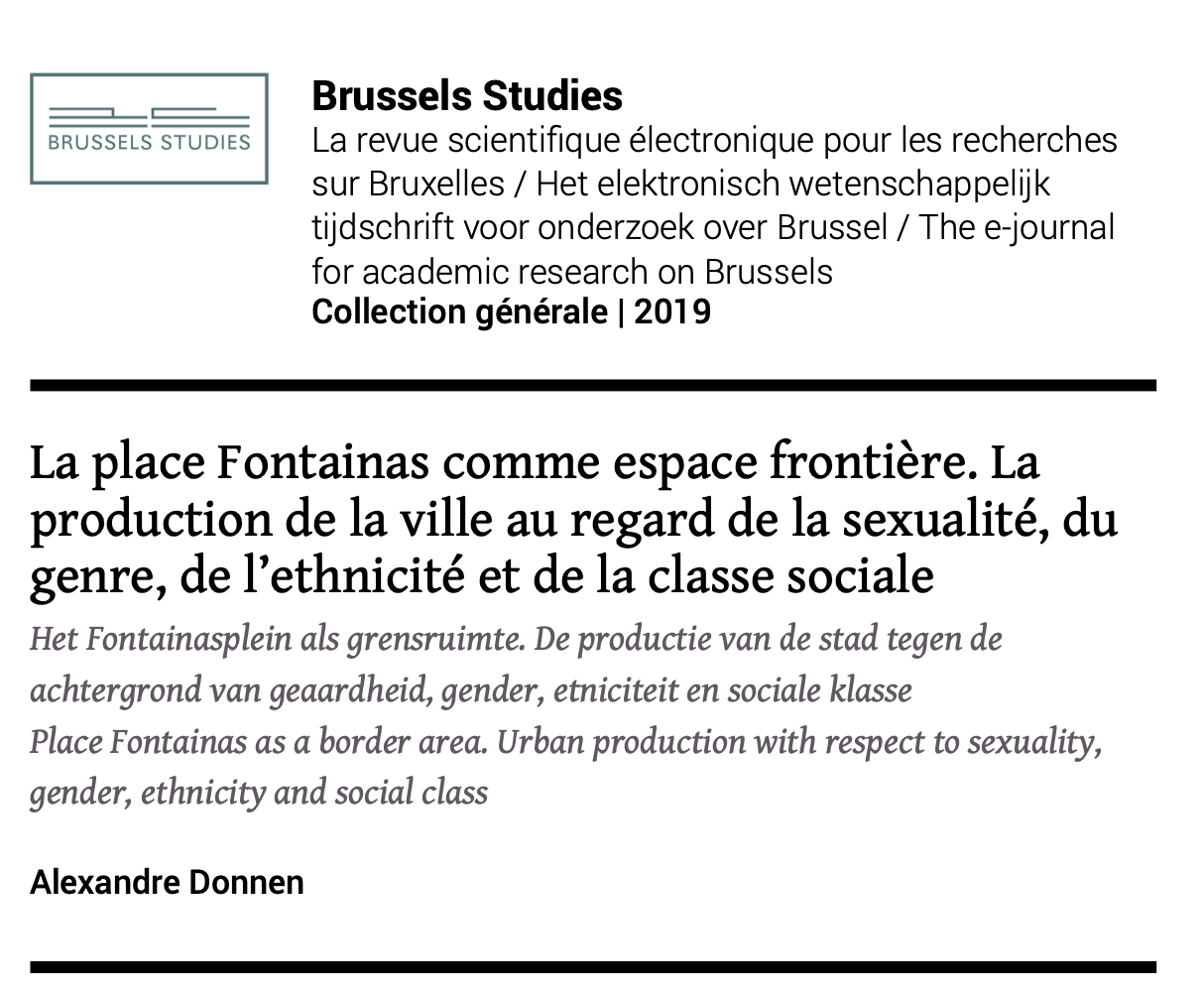
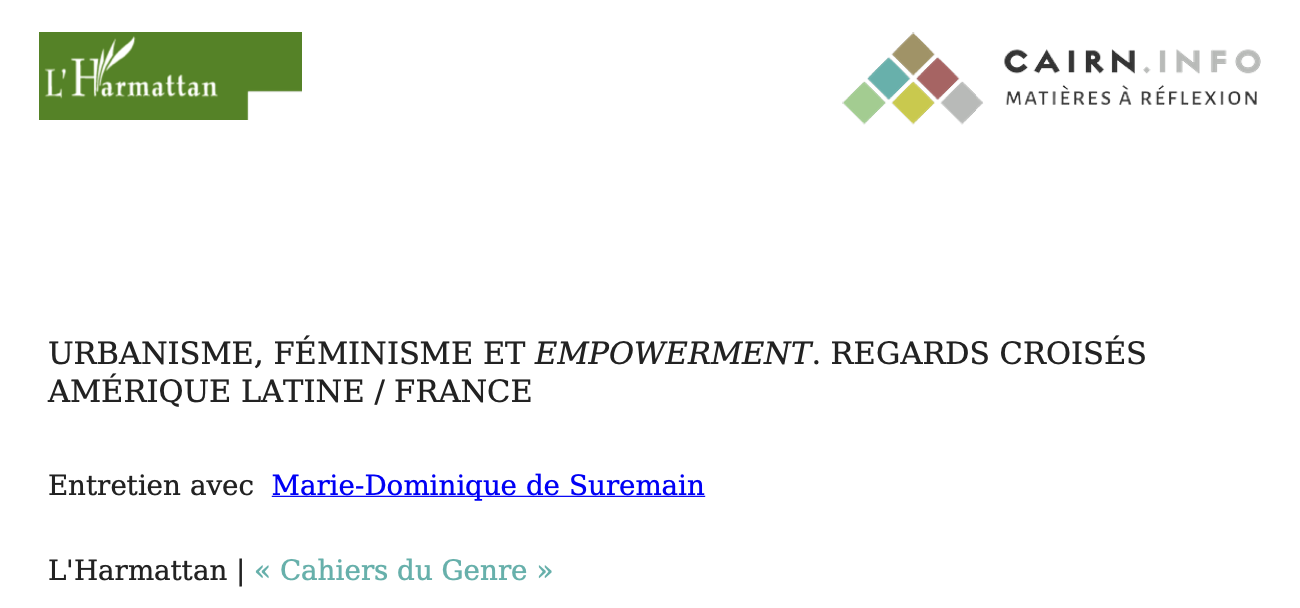
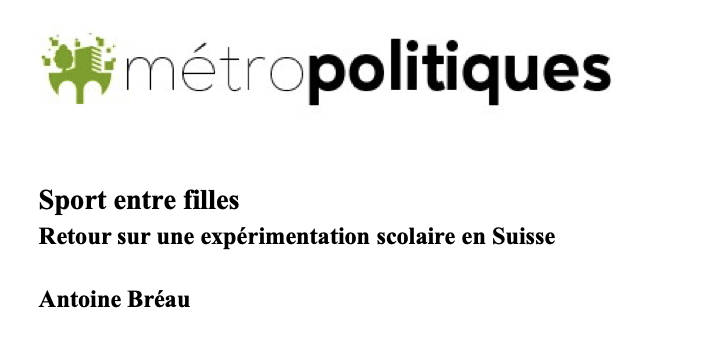







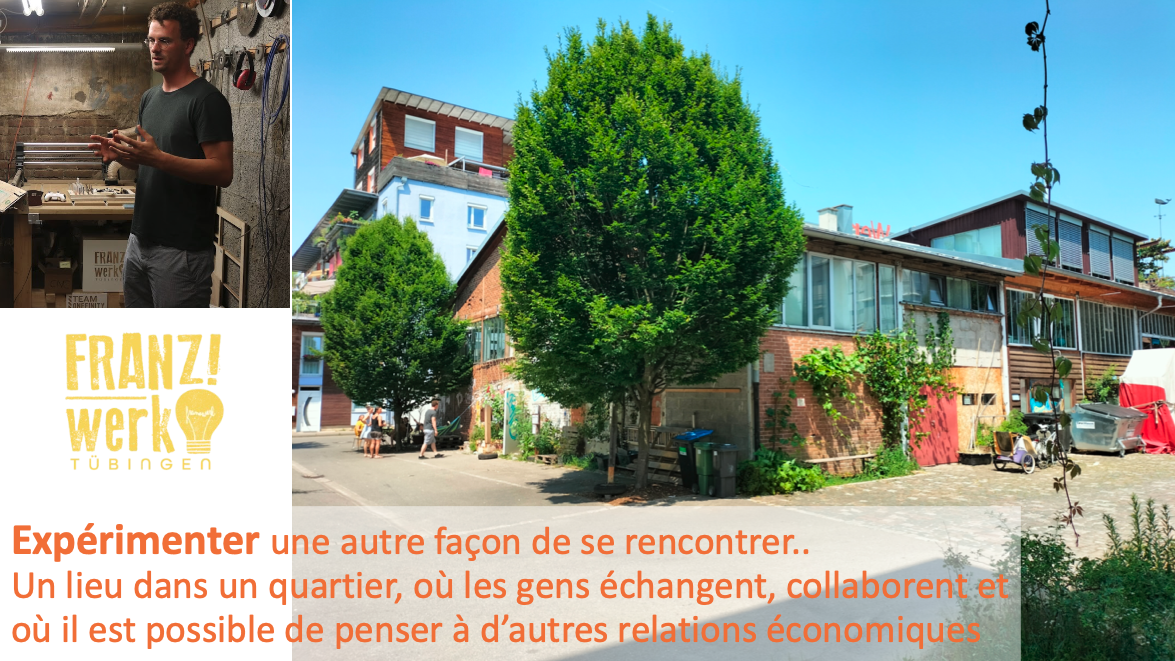






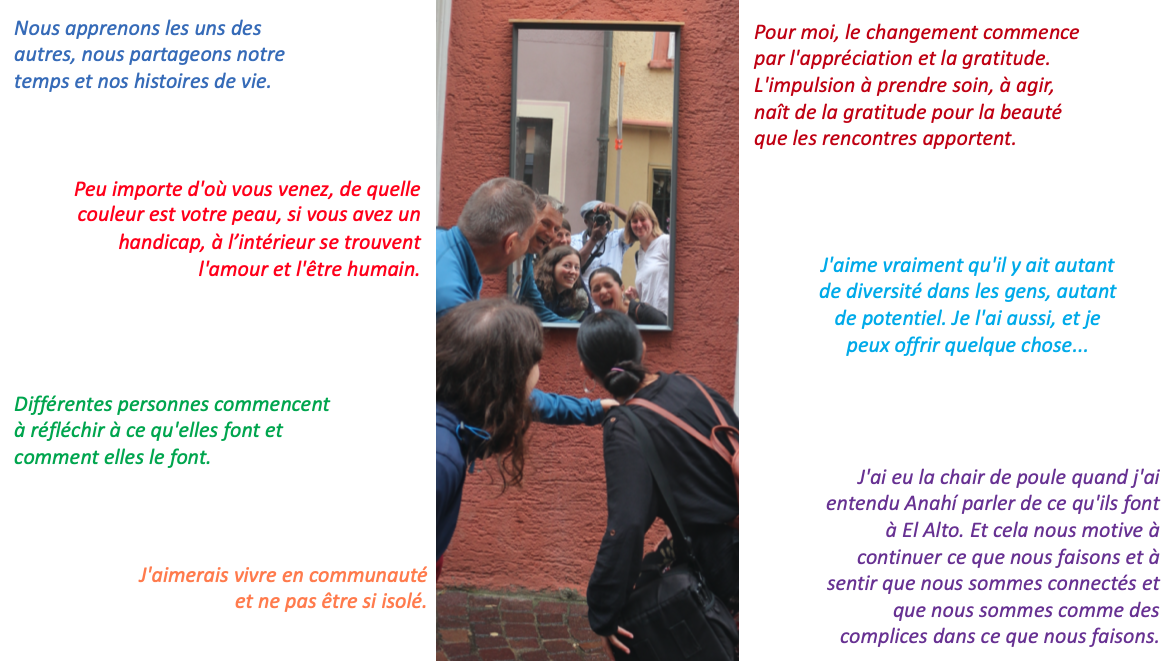





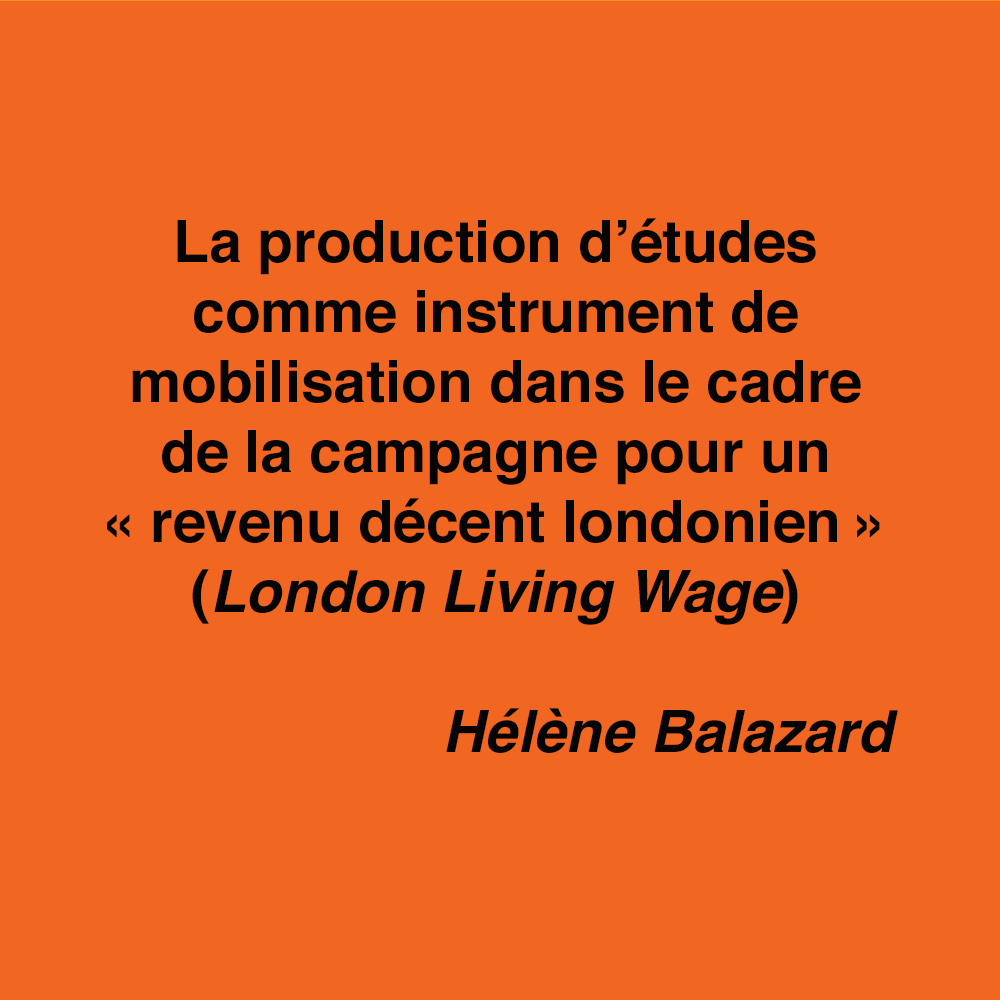
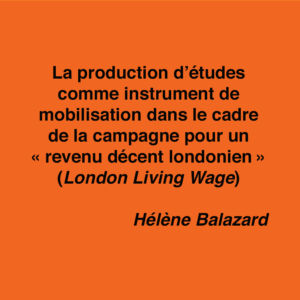
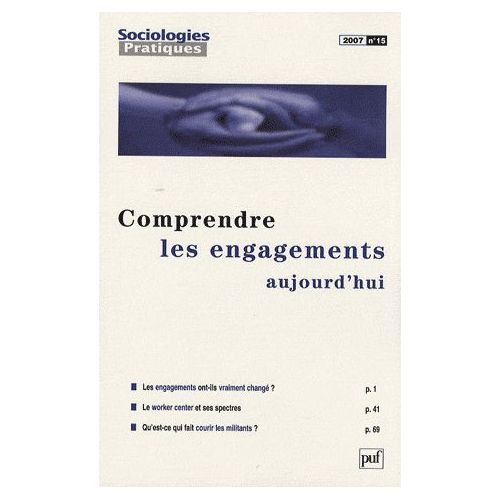
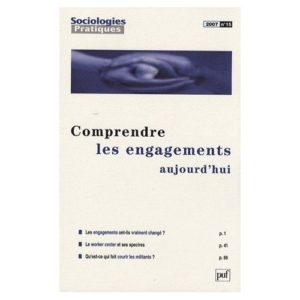
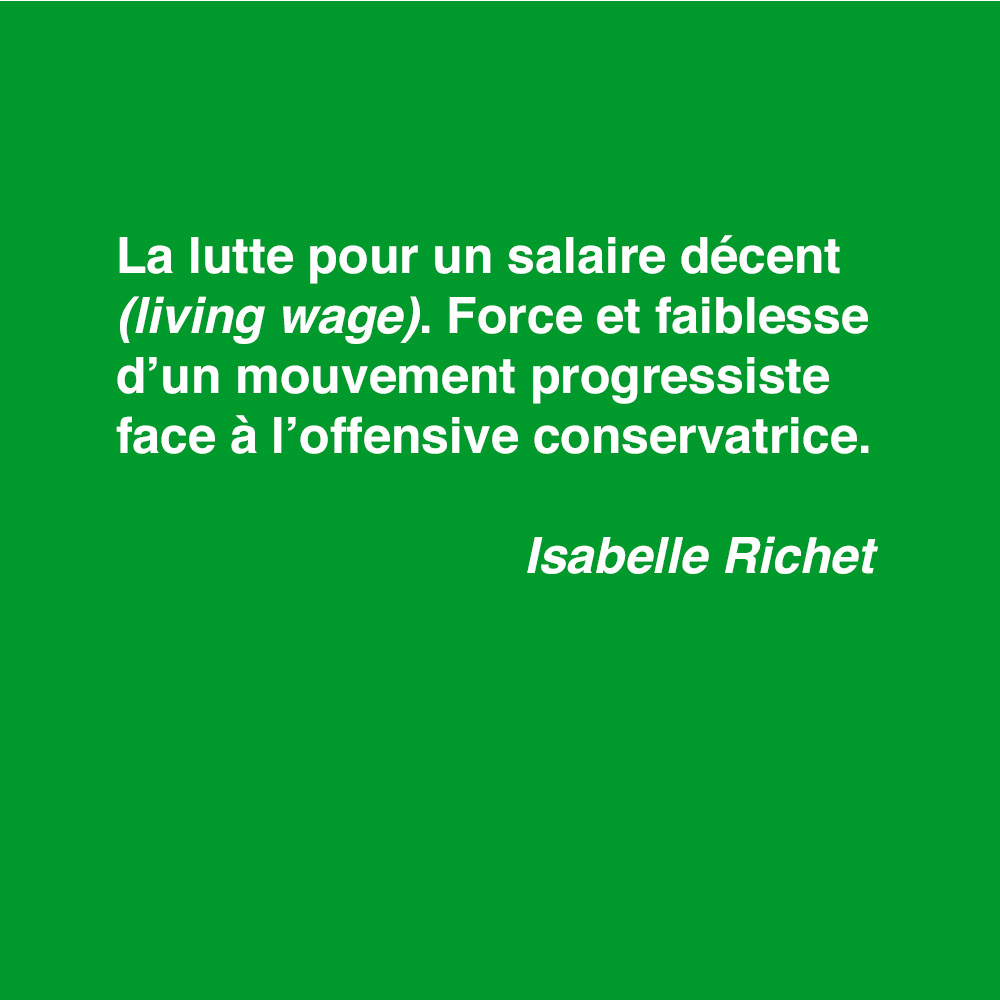
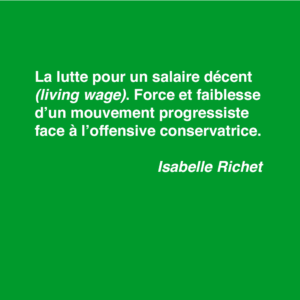
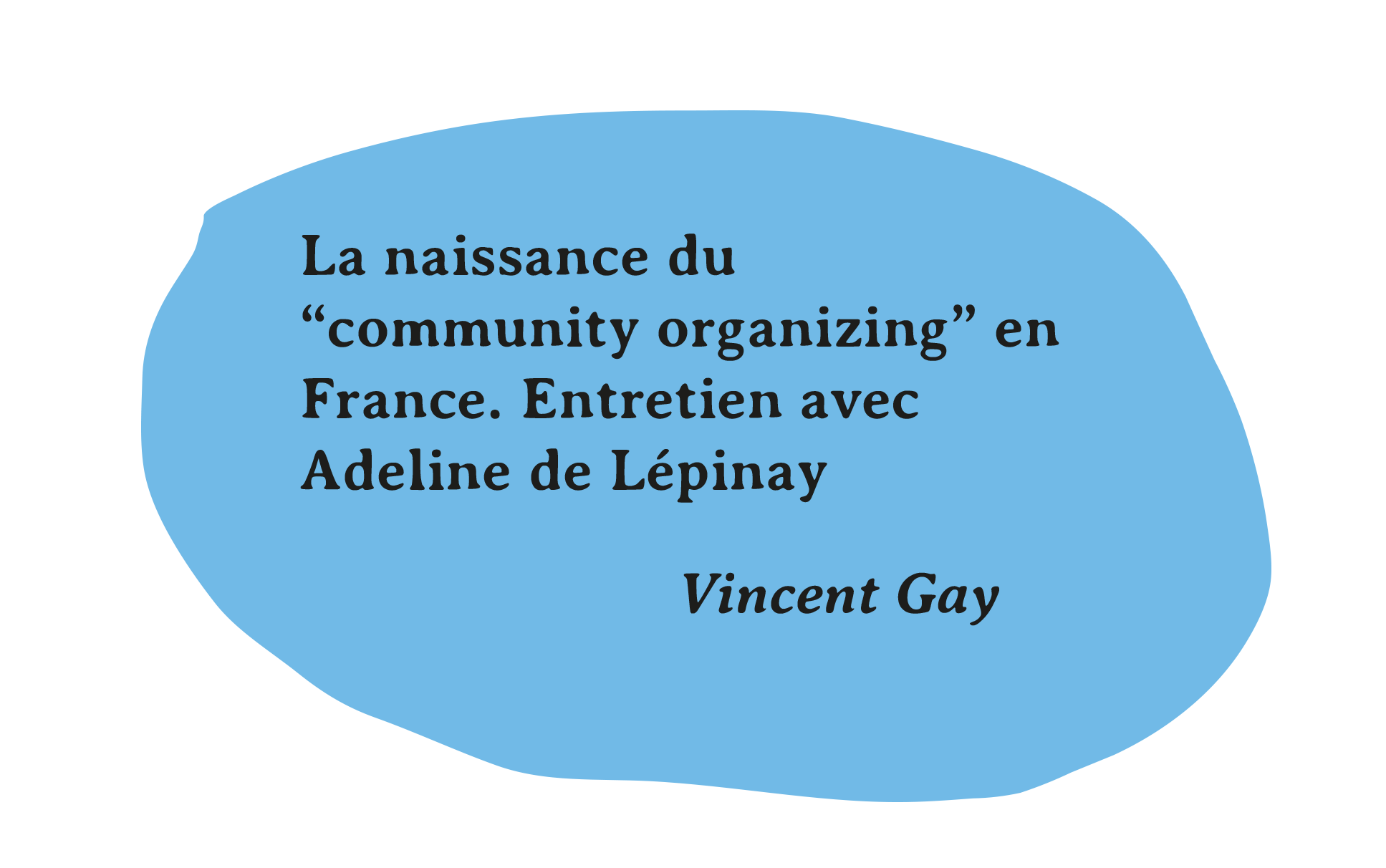
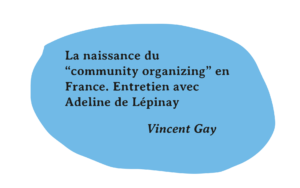
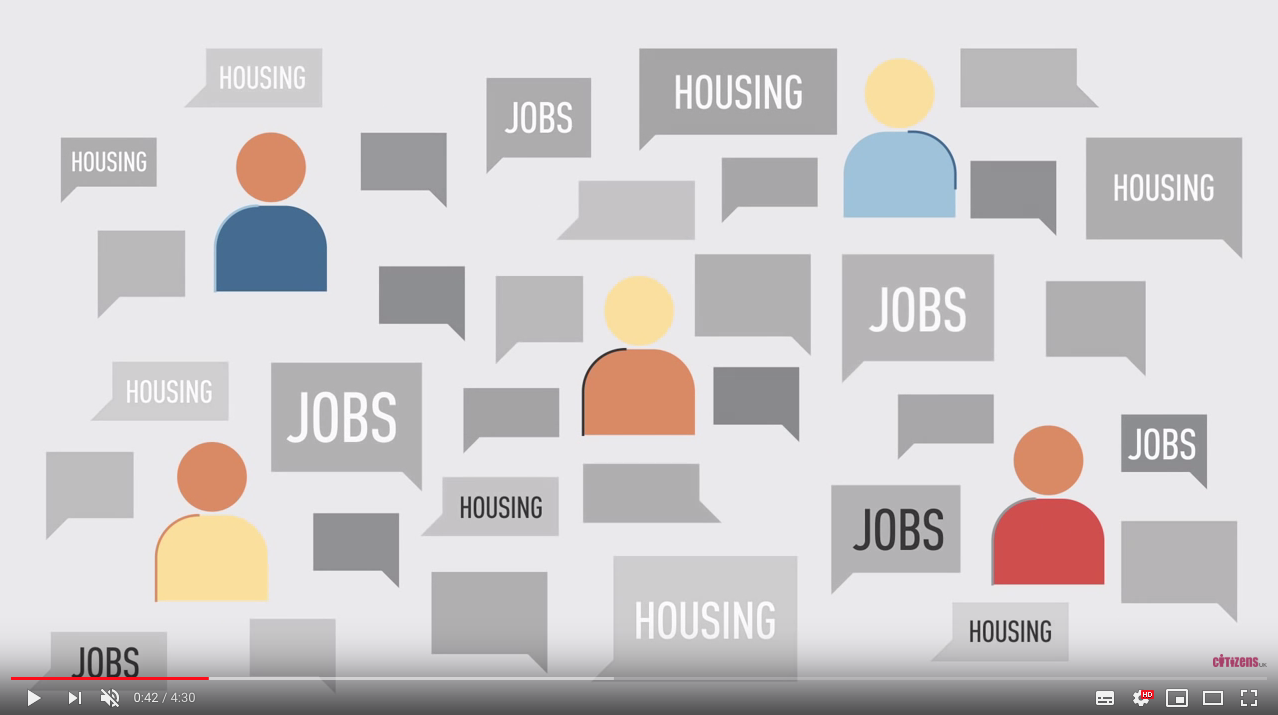

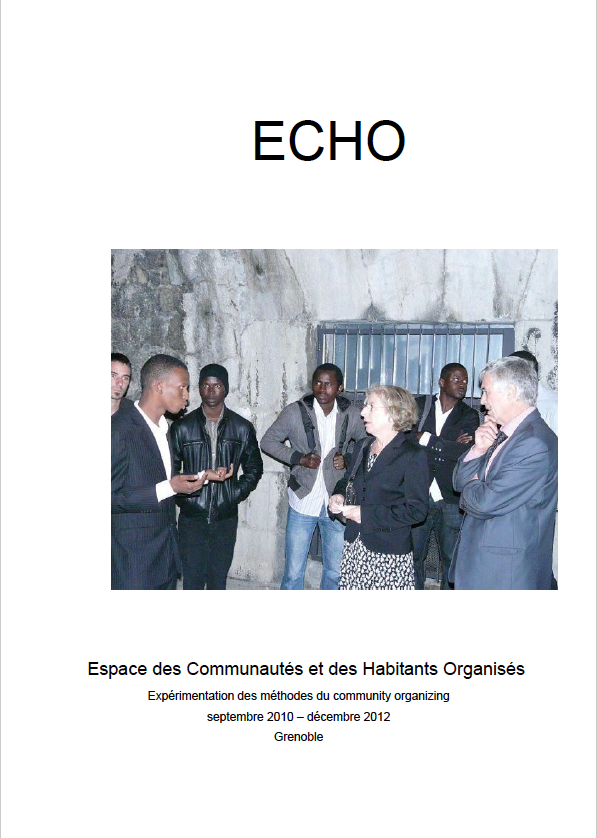
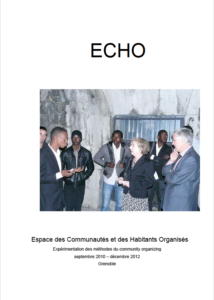

 Diffusé en avril 2016 sur la chaîne Public Sénat
Diffusé en avril 2016 sur la chaîne Public Sénat